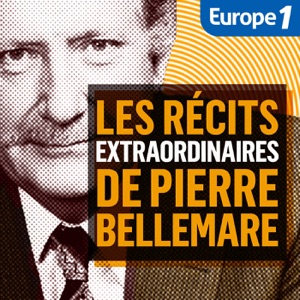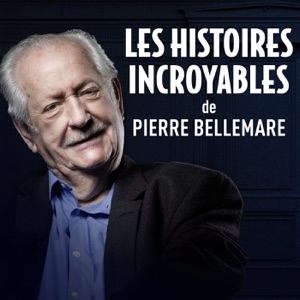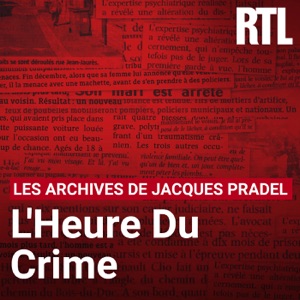Filtrar por género
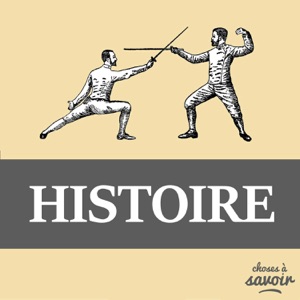
Développez votre culture en Histoire !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
- 1477 - Pourquoi le vinalon est-il célèbre en Corée du nord ?
Pays coupé du monde, la Corée du Nord adopte souvent, et ce dans tous les domaines, des solutions qui lui sont propres. C'est également le cas en matière vestimentaire.
Les autorités ont en effet décidé de développer une fibre synthétique, le vinalon, produite à partir d'anthracite et de calcaire. C'est le seul pays au monde à l'avoir fait.
Le vinalon est découvert, en 1939, par Ri Sung-gi, un chimiste né au sud de la péninsule coréenne, mais qui s'installe en Corée du Nord dans les années 1950, après la guerre de Corée. Le vinalon est la seconde fibre synthétique à avoir été découverte, peu après le nylon.
Mais la production ne débutera vraiment qu'à partir du milieu des années 1950.
Si le choix de fabriquer des vêtements à partir de cette fibre a été fait par la dictature nord-coréenne, c'est parce qu'ils pouvaient être produits sur place, notamment dans l'usine de Hamhung, le principal site de production du pays, et à partir des ressources locales.
En effet, le pays compte de nombreuses mines d'anthracite. Ainsi, le développement du vinalon entre dans cette politique d'autarcie chère au régime, qui est censée lui permettre de dépendre le moins possible de l'étranger.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dont la Corée du Nord sort très appauvrie, ce choix s'impose encore plus. En effet, le pays ne dispose pas, ou du moins en quantité suffisante, de la laine, du coton ou du pétrole qui lui permettraient d'habiller ses habitants. C'est pourquoi cette fibre fabriquée avec du charbon et des pierres est considérée comme un véritable cadeau du ciel.
Les Nord-Coréens n'ont pas l'habitude de critiquer les décisions de leur gouvernement. La moindre protestation pourrait en effet leur coûter cher, ainsi qu'à leurs familles.
Aussi sont-ils bien obligés de s'accommoder des vêtements fabriqués à partir de cette fibre. Il est vrai qu'elle est solide et que de tels vêtements peuvent être portés longtemps.
Mais le vinalon a aussi la réputation d'être rêche et d'un contact peu agréable. Elle est même réputée pour produire le tissu le plus inconfortable au monde.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 25 Apr 2024 - 2min - 1476 - Quelle est l'origine des anneaux des Jeux Olympiques ?
Chacun connaît le symbole des Jeux olympiques : cinq anneaux entrecroisés, de couleurs différentes. Les anneaux sont disposés sur deux étages, le premier constitué, de gauche à droite, de cercles bleu, noir et rouge. On trouve en-dessous, et toujours de gauche à droite, deux autres anneaux, jaune et vert.
Fils de peintre, Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux olympiques modernes, appréciait les arts. Aussi ne laissa-t-il à personne le soin de dessiner ce qui aillait devenir le symbole officiel des Jeux olympiques.
Représentant les cinq continents, ces anneaux sont un symbole d'union entre les peuples, un symbolisme encore accentué par l'entrecroisement de ces figures. Aucune couleur n'est cependant associée à un continent en particulier.
Cet emblème en forme d'anneaux correspond donc parfaitement aux valeurs de l'olympisme, telles que les concevait Pierre de Coubertin. Il illustre cette idée de compétition amicale et de rencontre entre les athlètes du monde entier chère au fondateur de l'olympisme moderne.
Quant aux couleurs de ces anneaux, elles évoquent, avec le blanc du drapeau, celles des drapeaux adoptés par les pays participant alors à la compétition.
Il semblerait que Pierre de Coubertin se soit inspiré, pour ces anneaux olympiques, du symbole de l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques (USFSA), qu'il présida un temps. En effet, ce symbole se composait de deux anneaux entrelacés.
Depuis sa création, en 1913, ce symbole des Jeux olympiques a connu quelques modifications. Les Jeux prévus à Berlin, en 1916, ayant été annulés du fait de la guerre, c'est en 1920, aux Jeux d'Anvers, que ces anneaux figurent, pour la première fois, sur le drapeau olympique.
En 1957, le Comité international olympique (CIO) adopte officiellement cet emblème de l'olympisme, dans une version très proche de celle imaginée par le baron de Coubertin.
En 1986, le CIO décide cependant de créer des espaces entre les anneaux, avant de revenir, en 2010, à une figure dans laquelle, comme au début, les anneaux sont à nouveau reliés entre eux.
Mais si le symbole olympique adopté en 2010 fait figure de version officielle, il en existe cependant d'autres, admises par le CIO.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 24 Apr 2024 - 2min - 1475 - Pourquoi Paul Kern n'a-t-il pas dormi pendant 40 ans ?
Vous souffrez peut-être d'insomnies passagères ? Que diriez-vous si vous aviez été à la place de Paul Kern, qui reste une énigme pour la médecine ?
En 1915, ce Hongrois né en 1884 se bat dans les rangs de l'armée austro-hongroise. En juin 1915, il est gravement blessé à la tête. Il est alors opéré d'urgence. Les chirurgiens parviennent à le sauver en extrayant une balle logée dans son cerveau.
S'ensuivent trois jours de coma. Quand Paul Kern se réveille, il semble parfaitement guéri, même s'il souffre de fortes migraines. Mais un étrange effet secondaire se manifeste bientôt.
Dans les premiers jours suivant l'opération, en effet, le jeune homme ne parvient pas à trouver le sommeil. Mais il considère ces insomnies comme une conséquence de l'intervention.
Il reste confiant, pensant que ces troubles du sommeil seront passagers. Mais, les jours suivants, Paul Kern ne parvient toujours pas à s'endormir. Les mois et les années passent sans que le malheureux puisse dormir ne serait-ce qu'un instant.
Jusqu'à sa mort, en 1955, cet homme souffrira d'une insomnie perpétuelle. 409 ans sans dormir ! Au début, on l'envoie faire une cure dans une ville d'eaux, ce qui le repose un peu.
Mais, au fil des années, Paul Kern ressent des douleurs dans les bras et les jambes. Il a parfois du mal à s'exprimer et, pour trouver un peu de repos, il doit s'allonger un moment, des lunettes noires sur le nez.
Pour s'occuper, Paul Kern lit ou écoute la radio durant la nuit. Il fréquente aussi les dancings ou les cafés. Mais il lui arrive également de travailler sans arrêt durant 72 heures !
Il prend aussi du poids, car il mange autant durant la nuit que pendant la journée. Excédée de l'entendre marcher durant la nuit, et lassée de voir sa photo à la une des journaux médicaux, sa femme finit par le quitter.
Paul Kern demeure un mystère pour la science. Son cas a cependant poussé certains scientifiques à se poser la question d'une éventuelle suppression du sommeil.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 22 Apr 2024 - 1min - 1474 - Que sont devenus les enfants de Cléopâtre ?
On le sait, la célèbre Reine d'Égypte, Cléopâtre VII, dernière représentante de la dynastie lagide, fut la maîtresse de deux conquérants romains, Jules César et Marc-Antoine, qui furent aussi des rivaux.
Cléopâtre a un fils avec César, qu'on nomme Césarion. Il aura un destin tragique. En 30 avant J.-C., le jeune homme a 17 ans. Sur les instances de sa mère, il se joint à une caravane, qui se dirige vers la mer Rouge.
De fait, à la suite de la victoire d'Actium, en 31 avant notre ère, les armées d'Octave, le futur Empereur Auguste, ont envahi l'Égypte, pour défaire Cléopâtre et Marc-Antoine. Les deux souverains finissent par se suicider.
On ne sait pas avec précision quel sort fut réservé à Césarion. Mais il est probable que le jeune prince, qui pouvait se poser en rival d'Octave, fut assassiné sur l'ordre du futur Empereur.
Cléopâtre eut aussi des enfants avec Marc-Antoine. Ils paraissent enchaînés au triomphe d'Octave, lorsque celui-ci rentre à Romme en général victorieux.
L'éducation de la fille aînée, Cléopâtre Séléné, est confiée à la sœur d'Octave, Octavie, qui fut elle-même mariée à Marc-Antoine. Elle est donc la demi-sœur de Cléopâtre Séléné. Même si la jeune orpheline est la fille de l'ennemie jurée de Rome, Octavie s'y attache.
C'est elle qui encourage son frère, devenu l'Empereur Auguste, à proposer la jeune Cléopâtre pour épouse au Roi de Maurétanie, Juba II, alors souverain de Numidie. Le mariage a lieu en 25 avant J.-C.
Cléopâtre Séléné y reste jusqu'à sa mort, en l'an 5 avant J.-C , continuant à y faire vivre l'influence de sa mère et de l'Égypte lagide.
Cléopâtre et Marc-Antoine eurent deux autres enfants, Alexandre Hélios, frère jumeau de Cléopâtre Séléné, et Ptolémée Philadelphe. On ne sait rien de la vie de ces derniers rejetons de Cléopâtre et Marc-Antoine.
Les historiens pensent qu'ils sont morts jeunes, mais sans doute de causes naturelles. En effet, les documents cessent simplement de les mentionner, peu de temps après leur arrivée à Rome.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 21 Apr 2024 - 1min - 1473 - Pourquoi le droit du travail est-il né au Moyen Age ?
Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, le contrôle de l'État sur le travail est quasi inexistant. En effet, la réglementation des métiers relève, pour l'essentiel, des corporations. Ce sont des sortes d'associations, dont il faut faire partie pour exercer un métier.
Composées de maîtres et d'apprentis, les corporations fixent des règles strictes, tant sur les processus de fabrication ou les conditions de travail que sur l'embauche de main-d'œuvre ou les horaires.
Enfin, chaque corporation a le monopole de son activité et vérifie elle-même le respect des règles qu'elle édicte.
Au XIIIe siècle, le Roi Louis IX entend mieux contrôler ce monde du travail, notamment à Paris, qui lui échappe en partie. Pour cela, il crée, en 1266, une nouvelle fonction, celle de prévôt royal.
Cet agent de la Monarchie reçoit une mission très large. En effet, son rôle s'étend aussi bien à la justice ou à la perception des impôts qu'au maintien de l'ordre.
Mais le Roi le charge aussi d'identifier les nombreuses communautés de métiers parisiennes qui s'étaient multipliées à la faveur de la période de croissance économique débutée au XIIe siècle.
129 métiers sont ainsi recensés dans le Livre des métiers, que les prévôts royaux font rédiger vers 1268. Ce document ne se contente pas de dresser la liste de ces professions.
En effet, il ressemble à ce qu'on pourrait appeler le premier Code du travail. De fait, les rédacteurs de ce document s'attachent à rédiger les règlements des divers métiers qui, jusque-là, relevaient davantage de la coutume que du droit écrit.
Mais le Livre des métiers ne se borne à reproduire ces règlements, il tient à les homologuer à partir d'un certain nombre de critères. Il s'agit donc d'une sorte de cadre juridique, qui, pour l'une des premières fois en France, règlemente le travail.
Malgré cette activité de recensement et de contrôle, environ 40 % des activités économiques de la capitale échappaient encore à toute réglementation écrite. Nombre de métiers s'exerçaient donc en dehors de tout contrôle véritable.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 18 Apr 2024 - 2min - 1472 - Comment les nazis ont voulu « créer une race supérieure de Germains nordiques » ?
On sait qu'Hitler et les idéologues nazis avaient conçu l'idée fumeuse d'une race aryenne "supérieure" à tous les autres groupes humains. Pour les dignitaires du régime, ces hommes "parfaits", destinés à dominer tous les autres, devaient être grands, blonds et avoir les yeux bleus.
Un portrait qui permettait déjà d'opérer une sélection parmi les peuples existants, les Scandinaves correspondant mieux à cette description, dans l'esprit des nazis, que les Espagnols ou les Turcs par exemple.
Mais les nazis ne veulent pas se contenter de repérer ces hommes "supérieurs", ils entendent créer les membres de cette future élite, en favorisant leur naissance.
Le lieu d'éclosion de cette "race de seigneurs" sera le "Lebensborn". Placées sous l'égide des SS, et notamment de leur chef, Heinrich Himmler, ces établissements étaient à la fois des maternités, des crèches et des centres d'éducation.
Le premier "Lebensborn" ouvre en août 1936. Il y en aurait eu une dizaine en Allemagne, mais d'autres ouvriront dans les pays occupés par les nazis. Les historiens estiment à environ 8.000 le nombre d'enfants nés dans les centres allemands. En tout, environ 20.000 enfants auraient vu le jour dans ces maternités SS.
Les femmes mariées à des dignitaires nazis, en majorité des SS, étaient invitées à accoucher dans ces établissements. D'après certains auteurs, des femmes réputées "aryennes", après des examens spécifiques, pouvaient rencontrer dans ces lieux, de façon discrète, des dignitaires nazis.
Le fruit de leur union serait alors élevé dans le "Lebensborn" dans lequel elles avaient secrètement accouché. La plupart de ces enfants étaient ensuite adoptés par des familles "aryennes".
Mais on y trouvait aussi des milliers d'enfants nés de l'union entre des soldats allemands et des femmes rencontrées dans les pays occupés et jugées aptes à donner naissance à des êtres "supérieurs".
D'autres enfants, jugés conformes aux critères de "pureté raciale" des nazis, étaient même enlevés à leurs familles et élevés dans ces établissements. Dans ce cas, ils étaient conditionnés et transformés en bons Allemands, fidèles à leur nouvelle patrie et à leur Führer.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 17 Apr 2024 - 2min - 1471 - Qui est la «hyène d'Auschwitz » ?
Surnommée la "hyène d'Auschwitz" ou la "bête de Belsen", Irma Grese est l'une des figures de tortionnaires les plus sinistres qu'ait pu produire l'Allemagne nazie.
Irma Grese naît en 1923 dans une famille d'agriculteurs. Sa mère se suicide durant son adolescence. Élève médiocre et solitaire, elle entre dans la "Ligue des jeunes filles allemandes", un mouvement de jeunesse nazi.
Puis, après avoir exercé divers métiers, dont celui d'aide-soignante dans un hôpital de la SS, elle intègre, en 1942, une école formant des gardiennes de camps de concentration.
En 1942, Irma Grese débute sa carrière de gardienne auxiliaire à Ravensbruck, un camp de concentration pour femmes. Elle y fait sans doute fait la connaissance de Dorothea Binz, une autre geôlière SS, connue pour sa cruauté sadique.
Se sentant apparemment dans son élément, Irma Grese est mutée a Auschwitz en 1943, et connaît une rapide promotion. Elle devient en effet surveillante-chef. C'est dans ces fonctions qu'elle montrera la férocité qui lui valut ses divers surnoms.
Durant le procès de la tortionnaire nazie, en 1945, les survivantes raconteront les sévices qu'elle infligeait aux détenues. Il est question de tortures diverses, de détenues rouées de coups ou froidement abattues à coups de révolver, de chiens lâchés contre les prisonnières ou d'interminables flagellations. Par ailleurs, Irma Grese aurait participé personnellement à la sélection des détenues pour la chambre à gaz.
Les rescapées parlent aussi d'abus sexuels. Qu'elle mutile les détenues, en leur coupant les seins, ou qu'elle assiste aux expérimentations médicales, la "hyène d'Auschwitz" semblait éprouver une véritable excitation sexuelle au spectacle de la souffrance.
Comme d'autres gardiennes, Irma Grese nie les faits qui lui sont reprochés lors de son procès. Elle prétend que si une détenue se pliait aux règles fixées par la direction du camp, elle n'était pas inquiétée.
Fidèle jusqu'au bout à ses convictions nazies, elle ose déclarer qu'elle se devait d'éliminer ce qu'elle continue d'appeler des "éléments antisociaux".
Reconnue coupable, Irma Grese est finalement pendue, avec 12 autres condamnés, le 13 décembre 1945.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 15 Apr 2024 - 2min - 1470 - Spartacus a-t-il vraiment existé ?
Popularisée par le film éponyme de Stanley Kubrick, l'épopée de Spartacus, gladiateur révolté contre les Romains, est devenue, avec le temps, un symbole de liberté, celui d'un peuple capable de secouer le joug de ses oppresseurs.
Mais que sait-on vraiment de Spartacus ? En fait, très peu de chose. Les historiens semblent du moins s'accorder sur un point : celui de l'existence historique de ce personnage un peu fabuleux.
On dispose de peu de sources pour raconter sa vie, la plus importante étant l'œuvre de l'historien romain Salluste. Mais si celui-ci mentionne bien les hauts faits de Spartacus, il n'indique même pas sa date de naissance.
Aussi peut-on seulement supposer qu'il a dû naître vers 100 avant J.-C.
D'après ce que nous savons, il est probable que Spartacus ait vu le jour en Thrace, une région occupée aujourd'hui par la Bulgarie et une partie de la Turquie. Mais on ne connaît pas son lieu de naissance exact.
Peu bavardes, les sources dont on dispose nous apprennent que Spartacus, appartenant à un peuple dépendant de Rome, s'est engagé dans l'armée romaine, non pas dans une légion, mais dans les troupes auxiliaires.
Les qualités de chef qu'il aura l'occasion de déployer, ainsi que sin aisance en selle, ont incité certains historiens à lui prêter des origines aristocratiques. Lassé de sa vie militaire, Spartacus aurait fini par déserter et devenir une sorte de brigand.
Arrêté vers 75 avant J.-C, sa force et son adresse sont remarquées, ce qui lui vaut de devenir gladiateur.
En 73 avant J.-C., Spartacus se soulève contre Rome et, durant deux ans, conduit une révolte d'esclaves que les historiens appellent la "troisième guerre servile".
Se réfugiant alors sur les pentes du Vésuve, dans le sud de l'Italie, et rejoint par d'autres esclaves, et nombre de mécontents, il aurait regroupé sous son autorité entre 40.000 et 70.000 hommes.
En 71 avant notre ère, Spartacus est pourtant vaincu et meurt au combat. La répression est féroce : environ 6.000 esclaves révoltés sont crucifiés sur la voie Appia, la grande artère partant de Rome.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 14 Apr 2024 - 2min - 1469 - Comment l'opéra est-il né ?
L'opéra raconte une histoire, celle imaginée par le livret, mise en musique par un compositeur et interprétée par des chanteurs lyriques. Il s'agit donc d'un spectacle complet, porté par les accents de l'orchestre.
Le théâtre grec, dans l'Antiquité, et certains ballets de cour, à l'époque de la Renaissance, ont pu donner un avant-goût de l'opéra, dont la naissance remonte au début du XVIIe siècle.
C'est en effet à ce moment que ce type de spectacle apparaît à Florence, capitale du grand-duché de Toscane. On le doit aux initiatives d'un petit groupe d'artistes et d'intellectuels, la "Camerata fiorentina" ou "Camerata de Bardi".
Les musicologues s'interrogent sur le premier opéra à avoir été écrit. Les avis divergent à ce sujet. Si l'on se fonde sur la composition même de l'œuvre, il semble bien que "La Dafne", du compositeur italien Jacopo Peri, ait été le premier opéra jamais composé.
En effet, il en écrit la musique, sur un livret d'Ottavio Rinuccini, à l'occasion du carnaval florentin de 1597. Le même musicien compose la musique d'un autre opéra trois ans plus tard, en 1600, sur un texte dû au même librettiste. Il s'agit d'"Euridice", d'après le mythe d'Orphée, qui sera représenté pour la première fois en octobre 1600 au palais Pitti de Florence.
Si l'on prend comme critère la représentation de l'œuvre, "Euridice" peut encore être considéré comme le premier opéra. D'autant que Jacopo Peri a introduit dans sa partition des éléments, comme les duos, les chœurs ou les solos, que l'on retrouvera dans tous les opéras à venir.
Pour certains, cependant, la première œuvre musicale méritant vraiment le nom d'opéra est l'"Orfeo" de Claudio Monteverdi, sur un livret d'Alessandro Striggio. Créé en février 1607 à Mantoue, cet opéra marque la transition entre la musique de la Renaissance et celle de l'époque baroque.
L'opéra italien sera introduit en France, dès le milieu du XVIIe siècle, grâce à Mazarin qui, fin mélomane, fait représenter plusieurs de ces œuvres à la Cour de France.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 11 Apr 2024 - 2min - 1468 - De quelles maladies Louis XIV a-t-il souffert ?
Louis XIV avait une santé de fer. En effet, il est mort à 77 ans, un âge très respectable pour l'époque, après avoir résisté, durant toute son existence, aux soins de médecins parfois plus dangereux que les maladies qu'ils étaient censés soigner.
Par contre, le Roi n'a pas joui d'une bonne santé. Il fut très souvent malade. Dans sa jeunesse, il est atteint de gonorrhée, une maladie sexuellement transmissible, et d'une fièvre typhoïde qui menace sa vie.
Les miasmes de Versailles, où le château est construit sur un terrain marécageux, lui font sans doute attraper le paludisme.
Un régime alimentaire déplorable et une hygiène bucco-dentaire inexistante provoquent d'autres maux. Comme tous les Bourbons, le Roi est en effet un gros mangeur. Et il consomme de la viande en abondance, dont beaucoup de gibier, et une grande quantité de sucreries.
Avec une telle alimentation, les crises de goutte, accompagnées de douloureuses coliques néphrétiques, ne tardent pas à se déclarer. Une maladie invalidante et provoquant de vives douleurs.
Par ailleurs, le sucre et une mauvaise hygiène dentaire entraînent des caries. Ainsi, le Roi perd ou se fait enlever une bonne partie de ses dents. L'une de ces opérations dentaires se passe mal et la mâchoire royale est perforée. Désormais, quand le monarque boit, l'eau passe par son nez !
Comme le Roi ne mâche pas suffisamment sa nourriture, son estomac est mis à rude épreuve et il souffre de troubles digestifs.
Son goût pour les pâtisseries explique aussi le diabète dont souffrait le souverain. Un mal qui finira par causer sa perte. À la fin de sa vie, en effet, des taches noires apparaissent sur le pied et la jambe gauches du Roi.
Soignée avec du lait de chèvre et des herbes aromatiques, la gangrène ne cesse de progresser. Elle finira par emporter Louis XIV, le 1er septembre 1715, après une longue et très douloureuse agonie.
Il faut enfin noter que le Roi sera également opéré avec succès d'une fistule anale, sans doute provoquée par les clystères mal stérilisés avec lesquels on lui administra de très nombreux lavements.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 10 Apr 2024 - 2min - 1467 - Pourquoi parle-t-on du « printemps des peuples » ?
Pour écouter l'épisode: D'où vient l'expression "à un de ces quatre":
Apple Podcasts:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/0YJ39KAFUm7h61LRzcjvRe?si=a6a83b18f19747ca
-------------------------
En 1848, une partie de l'Europe est la proie d'un ensemble de mouvements populaires que les historiens ont baptisé le "printemps des peuples". Cette appellation tient à la période durant laquelle ces soulèvements se sont déroulés, entre mars et juin 1848 pour la plupart.
La cause essentielle est à rechercher dans la manière dont l'Europe a été organisée à la suite de l'épisode révolutionnaire en France et des guerres napoléoniennes.
En 1815, en effet, le congrès de Vienne, qui réunit, sous l'égide du prince de Metternich, chancelier d'Autriche, les pays vainqueurs de Napoléon, rétablit une Monarchie autoritaire dans tous les pays concernés.
Par ailleurs, de nombreux peuples font toujours partie de vastes ensembles multinationaux, comme l'Empire d'Autriche ou l'Empire russe.
Le système est encore renforcé, en 1815, par le pacte de la Sainte-Alliance, conclu entre les pays vainqueurs, qui doit veiller sur l'œuvre du congrès et éviter les débordements révolutionnaires.
Or, cette réorganisation du continent est contestée partout en Europe. Elle l'est d'abord par tous les libéraux. Influencés par la Révolution française, ils réclament plus de démocratie et le respect des droits de l'Homme.
Elle est également remise en cause par les nationalistes, qui demandent l'indépendance pour chaque peuple. Certaines nationalités avaient d'ailleurs déjà obtenu satisfaction : en 1830, en effet, les Grecs s'étaient dégagés du joug ottoman et les Belges s'étaient soustraits à la domination hollandaise.
En 1848, des soulèvements éclatent donc partout en Europe. En févier, les émeutes qui éclatent à Paris chassent Louis-Philippe et remplacent la Monarchie de Juillet par la IIe République.
Même si ces événements ne sont pas les premiers à se dérouler à ce moment-là en Europe, ils vont déclencher une véritable cascade de mouvements révolutionnaires à travers tout le continent.
Certains frappent les divers États italiens, amorçant ainsi le processus qui conduira à l'unité de la péninsule. D'autres se produisent en Allemagne et dans l'Empire d'Autriche.
Sauf en France, ces soulèvements sont réprimés et n'ont pas de résultats immédiats. Mais leur influence se fera sentir dans les décennies à venir.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 08 Apr 2024 - 2min - 1466 - Que sont devenus les enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette ?
On le sait, Louis XVI et Marie-Antoinette ont été guillotinés durant la Révolution française, le premier le 21 janvier 1793, la seconde le 16 octobre de la même année.
Mais que sont devenus les enfants du couple royal ? Sur les quatre enfants nés de cette union, deux, Louis-Joseph et Sophie-Béatrice sont morts en bas âge, avant le déclenchement de la Révolution.
De son côté, Louis-Charles de France, né le 27 mars 1785, devient dauphin, donc successeur désigné de son père, à la mort de son frère aîné, en 1789. En 1791, il sera désigné comme prince royal.
Après la journée du 10 août 1792, qui marque la fin de la Monarchie, le dauphin est enfermé, avec ses parents et sa sœur, dans la prison du Temple. À la mort de son père, en janvier 1793, le jeune prince est reconnu Roi par les royalistes, et la plupart des pays étrangers, sous le nom de Louis XVII.
En juillet 1793, Louis-Charles est enlevé à sa mère et confié à un cordonnier, qui doit transformer le petit prince en un citoyen ordinaire. Laissé seul, dans une chambre obscure, l'enfant, rongé par la tuberculose, se réfugie dans le silence. Il meurt le 8 juin 1795, à l'âge de dix ans.
Premier enfant du couple royal, Marie-Thérèse de France, appelée "Madame Royale", naît le 19 décembre 1778. En 1792, elle suit ses parents et son frère à la prison du Temple.
Après l'exécution de sa mère et celle de sa tante, Madame Elisabeth, en mai 1794, la jeune princesse se retrouve seule. Elle devient dès lors "l'orpheline du Temple". En décembre 1795, la princesse est finalement échangée contre des prisonniers français.
Elle est alors accueillie, à la Cour de Vienne, par la famille de sa mère. En juin 1799, elle épouse son cousin germain, le duc d'Angoulême, fils aîné du futur Charles X. Rentrée en France à la Restauration, en 1814, elle doit de nouveau s'exiler en 1830 et, en 1851, meurt sans descendance au château de Frohsdorf, en Autriche.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 07 Apr 2024 - 2min - 1465 - Hitler aurait-il pu devenir peintre ?
Le destin du monde n'a pas seulement été influencé par le nez de Cléopâtre, mais aussi par le pinceau d'Hitler. En effet, si son coup de pinceau avait été plus adroit, il aurait peut-être fait carrière dans les arts et ne serait pas devenu l'un des dictateurs les plus sanglants que l'Histoire ait connus.
Car Hitler se piquait d'être un artiste. Il se présente ainsi par deux fois, en 1907 et 1908, à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Ses toiles sont jugées sévèrement par un jury qui déplore une exécution "malhabile" et une "ignorance des techniques".
Pour subsister, Hitler peint alors des cartes postales qu'un ami, qui se fait passer pour aveugle, tente de vendre aux passants. Et il continue à faire des aquarelles. Il en aurait peint un grand nombre, 2.000 ou 3.000 sans doute.
Par contre, Hitler affirme dans "Mein kampf" qu'il n'a jamais été peintre en bâtiment, comme le veut une rumeur qui n'a pas de fondement solide.
La question de l'éventuel talent d'Hitler, en tant que peintre, relève de la subjectivité. Quant à savoir s'il se vengea de ses frustrations d'artiste en se laissant posséder par la folie meurtrière qui devait l'habiter par la suite, ce sont là de simples spéculations.
Quoi qu'il en soit, les toiles d'Hitler sont réapparues après la guerre. Les spécialistes estiment que seulement 10 % de son œuvre aurait survécu. Il est cependant difficile d' authentifier ces toiles. Il existe en effet beaucoup de faux.
Ainsi, sur les 700 tableaux attribués à Hitler, dans un catalogue présenté en 1983, les deux tiers seraient des faux. Depuis le début des années 2.000 des tableaux sont vendus, dont de nombreuses aquarelles.
Ce qui n'a pas manqué de susciter des polémiques. Pourtant, les sujets de ces toiles, des paysages urbains ou champêtres le plus souvent, n'ont aucun caractères délictueux. Hitler les a d'ailleurs peintes, pour la plupart, avant d'accéder au pouvoir.
Il est à noter, enfin, que certaines aquarelles se sont négociées à 14.000 et même à 18.000 euros.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 04 Apr 2024 - 1min - 1464 - Quelle est l'origine de la légende d'Excalibur ?
Toute une légende s'est forgée autour du mythique Roi Arthur. L'existence historique de ce personnage semble assez douteuse à la majorité des historiens. Les récits légendaires le font naître à la fin du Ve siècle.
Il serait le fils d'Uther Pendragon, qui régnait sur la Bretagne, un royaume correspondant à la Grande-Bretagne actuelle.
Durant son enfance, l'identité du jeune Arthur aurait été tenue secrète. Le Roi en aurait confié la garde à Merlin l'Enchanteur. Ce personnage fabuleux, né d'une mère humaine et d'un père diabolique, serait le créateur du fameux site de Stonehenge.
À la mort d'Uther Pendragon, plusieurs prétendants se disputent le trône. C'est alors qu'intervient Merlin. La veille de Noël, il convoque ces seigneurs et leur lance un défi.
Il leur présente en effet un rocher, qui vient d'apparaître dans la nuit. Dans ce roc est plantée une épée. Le magicien demande à chacun d'eux de la retirer de son socle. Celui qui y parviendra deviendra Roi de Bretagne.
Tous les chevaliers s'y essaient, l'un après l'autre, mais sans succès. Malgré tous leurs efforts, l'épée reste plantée dans son rocher. C'est alors que paraît le jeune Arthur, qui passe pour un simple écuyer.
À peine le jeune homme frêle s'est-il emparé de la poignée de l'épée que celle-ci se retire de son socle comme par enchantement. Arthur est aussitôt reconnu comme leur souverain légitime par les seigneurs médusés.
Dans le cycle arthurien, Excalibur deviendra dès lors l'épée du jeune Roi. Ce n'est pas une arme comme les autres. Elle aurait été forgée par des elfes, à la demande d'une fée, la Dame du Lac, une amie de Merlin, dont il était même amoureux. D'après la légende, ils l'auraient fabriquée dans un métal particulier, que rien ne pouvait briser.
Muni de cette épée magique, Arthur était assuré de vaincre ses ennemis. Il s'agissait surtout des Saxons, qui convoitaient alors la Bretagne. Mieux encore, le fourreau de l'épée le protégeait en toute circonstance. Rien ne pouvait donc arriver à ce jeune souverain, auquel la victoire était promise.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 03 Apr 2024 - 1min - 1463 - Pourquoi Eben Byers a-t-il été enterré dans un cercueil de plomb ?
Personne ne songerait aujourd'hui à s'approcher du radium. Issu de l'uranium, ce métal découvert par Pierre et Marie Curie est en effet très radioactif. Mais on ne voyait pas les choses ainsi au début du XXe siècle.
Non seulement on ne craignait pas le radium, mais on lui prêtait des vertus curatives. Aux États-Unis, on en fait même un remède miracle : le "radithor". On l'obtient en mélangeant tout simplement des sels de radium dans un peu d'eau distillée.
Cette boisson radioactive était réputée pour ses propriétés énergisantes. Elle avait enrichi son promoteur, qui se targuait faussement d'être médecin. Il prétendait même que le radithor pouvait guérir jusqu'à 150 maladies !
On ne s'étonnera pas qu'une telle préparation ait ruiné la santé des malheureux qui se laissèrent abuser par une publicité alléchante. Certaines de ces victimes sont plus connues que d'autres.
C'est le cas d'Eben Byers. C'est un industriel américain, né en 1880, qui reprend l'entreprise familiale. Il est aussi connu pour ses talents de golfeur.
En 1927, il se blesse au bras et, la douleur ne cessant pas, son médecin lui prescrit du radithor. Dès lors, cette boisson devient pour lui une véritable drogue. Il a en effet l'impression qu'elle améliore grandement sa santé.
Il est tellement satisfait des effets de ce produit miracle qu'il en parle à tous ses amis, faisant ainsi, sans le savoir, d'autres victimes du radithor.
L'industriel prend des doses de plus en plus massives, buvant, au total, le contenu d'environ 1.400 bouteilles. En fait, la consommation de ce produit hautement radioactif, qui se fixe dans ses os, lui vaut de contracter plusieurs cancers, qui finissent par provoquer son décès, le 31 mars 1932.
Entre autres maux, Eben Byers souffrait d'une grave affection du maxillaire, qui entraîne la chute de ses dents et la perte d'une partie de sa mâchoire inférieure.
À sa mort, on place son corps dans un cercueil de plomb, pour éviter la contamination. Trente plus tard, l'examen de la dépouille de l'industriel confirme la présence d'une forte radioactivité.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 01 Apr 2024 - 2min - 1462 - Pourquoi l'affaire Gouzenko est-elle célèbre ?
Le Soviétique Igor Gouzenko a été au centre d'une affaire d'espionnage un peu oubliée aujourd'hui. Affecté à l'ambassade soviétique à Ottawa, Gouzenko se rend compte, durant la Seconde Guerre mondiale, que son pays entretient un réseau d'espionnage au Canada.
Il est bien placé pour le savoir, puisqu'il s'occupe notamment de chiffrer les messages. Il se dit sans doute qu'il en sait un peu trop sur des questions qui doivent rester secrètes. Peut-être est-il également déçu par l'évolution politique de son pays.
Toujours est-il qu'en septembre 1945, il quitte l'ambassade et décide de demander l'asile politique. Il n'est pas parti les mains vides, puisqu'il a emporté avec lui une centaine de documents, dérobés dans les bureaux de l'ambassade.
Gouzenko s'adresse d'abord à un journal qui, trouvant l'affaire trop sensible, lui conseille de se rendre au ministère de la Justice.
Même si le ministre se montre assez circonspect, il juge l'affaire assez importante pour en parler au Premier ministre, Mackenzie King. Celui-ci informe alors le Président Truman et le Premier ministre britannique, Clement Attlee.
En attendant, Igor Gouzenko obtient l'asile politique dès septembre 1945, et se voit accorder une protection policière, pour lui et sa famille, qu'il a réussi à faire venir d'URSS.
L'affaire reste d'abord secrète, puis ces informations sont finalement divulguées par la presse, en février 1946. Une commission d'enquête est alors nommée, pour faire la lumière sur les faits rapportés par Gouzenko.
Elle conduit à l'arrestation de plusieurs personnes au Canada, dont un militaire et un député communiste. Au Royaume-Uni, des scientifiques travaillant pour le programme nucléaire britannique sont également appréhendés.
Pour autant, et même si cette affaire est parfois considérée comme le premier épisode de la guerre froide, les renseignements donnés par Gouzenko n'ont pas paru d'une grande importance à certaines des autorités de l'époque.
De son côté, Ivor Gouzenko, toujours protégé par la police, se sent menacé. C'est pourquoi il prend soin de changer souvent d'identité et de donner des interviews le visage masqué.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 31 Mar 2024 - 1min - 1461 - Quel est le vrai nom de Gustave Eiffel (et pourquoi a-t-il fait scandale) ?
On sait que Gustave Eiffel a donné son nom à l'un des monuments les plus visités au monde, et devenu aujourd'hui un véritable emblème de la France.
Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce patronyme, devenu célèbre, n'est pas le vrai nom de Gustave Eiffel. Il s'appelait en réalité Bonickhausen. La famille venait en effet d'Allemagne.
Mais elle avait fait ajouter à son nom celui d'"Eiffel", un plateau près de Cologne, d'où la famille était originaire. Chacun de ses membres se faisait donc appeler "Bonickhausen dit Eiffel".
Une précaution prise par l'ancêtre de Gustave Eiffel, un tapissier qui, s'installant à Paris, au début du XVIIIe siècle, avait sans doute jugé ce nom mieux adapté à sa nouvelle patrie.
Mais cet ajout ne sera pas suffisant pour masquer la consonance germanique du nom de l'ingénieur. Et il ne fait pas bon porter un nom allemand dans la France de cette époque.
En effet, les pays germaniques, et notamment la Prusse, sont alors mal vus des Français. Cette méfiance est perceptible dès le Second Empire, et elle ne fera que s'aviver à la suite de la guerre de 1870, qui verra la France écrasée par les Prussiens.
On comprend dès lors que le père de la tour Eiffel ait tout fait pour dissimuler son vrai nom. Mais ses adversaires ont tôt fait de le découvrir. Ils dénoncent ainsi le "soi-disant" Eiffel, derrière lequel se cacherait un espion allemand du nom de Bonickhausen. La révélation de ce nom à consonance germanique provoque un véritable scandale.
Cette identité fait également échouer plusieurs des projets matrimoniaux échafaudés par Gustave Eiffel. Découvrant son vrai nom, les familles concernées ne donnent pas suite.
En 1878, l'ingénieur, las de ces rebuffades, s'adresse au ministre de la Justice. Il désire renoncer définitivement au patronyme de Bonickhausen et demande à s'appeler désormais Gustave Eiffel.
Le Conseil d'État, qui est consulté, donne un avis favorable. Aussi, le créateur de la tour Eiffel est-il autorisé, en août 1881, à remplacer le nom de Bonickhausen par celui d'Eiffel.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 28 Mar 2024 - 2min - 1460 - Pourquoi le tsar Ivan IV est-il surnommé « le Terrible » ?
Le tsar Ivan IV, qui règne de 1547 à 1587, traîne après lui une sinistre réputation, qui lui a valu le surnom de "Terrible".
Il est d'ailleurs le dernier grand-prince de Moscou, une principauté née de la "Rus", cette première entité territoriale née autour de la ville de Kiev. Il est aussi le premier, du fait de ses annexions de territoires notamment, à porter le titre de "Tsar de toutes les Russies".
Son règne avait pourtant bien commencé. En effet, il réforme le clergé, fait paraître un nouveau code de lois et promet de protéger le peuple. Il commence aussi à moderniser un pays encore très archaïque.
Traumatisé par une enfance difficile, où l'orphelin qu'il était fut maltraité par ses tuteurs, et persuadé que tous se liguent pour l'assassiner, Ivan montre bientôt son véritable visage.
Obsédé en permanence par la peur du complot, le Tsar se livre aux pires cruautés, notamment sur les boyards, des nobles qu'il soupçonne de vouloir le trahir. Il en fait ainsi déporter et tuer des centaines. Il s'en prend aussi à leurs familles, dont il fait souvent exécuter tous les membres.
Ivan le Terrible ordonne même des exécutions de masse. En 1570, il fait ainsi tuer toute la population de Novgorod, qu'il accuse de trahison au profit de la Pologne.
Pour assouvir ses vengeances, le Tsar peut compter sur les "opritchniks", une milice composée de fidèles qui lui sont dévoués corps et âme. Il s'assure d'ailleurs de leur loyauté en donnant à ses sbires les terres des boyards, qu'il confisque sans vergogne.
Si Ivan IV est passé à la postérité comme un homme assoiffé de sang, c'est aussi en raison de la folie meurtrière qui semblait l'habiter. Elle lui inspirait en effet, dans les châtiments qu'il infligeait à ses opposants, un raffinement de cruauté inouï.
Entre autres supplices, il les plonge dans des chaudrons d'eau bouillante, les fait griller comme des rôtis à la broche ou les expose, dans des arènes dont ils ne peuvent s'échapper, à la dent d'ours affamés.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 27 Mar 2024 - 2min - 1459 - Pour quel motif Helen Duncan fut emprisonnée pour la dernière fois de l'Histoire ?
Entre le XVe siècle et le XVIIe siècle, de nombreuses personnes, dont une grande majorité de femmes, furent accusées de sorcellerie, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Puis ces procès se raréfient.
Ainsi, en Grande-Bretagne, une dernière "sorcière" fut brûlée vive en 1727. Mais voilà que cette accusation, qu'on croyait réservée à des temps révolus, resurgit en plein XXe siècle, plus précisément au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Elle vise une certaine Helen Duncan. Elle n'est pas accusée de pactiser avec le diable, mais de révéler des secrets militaires qui ne doivent pas tomber dans des oreilles indiscrètes.
Ces informations confidentielles, Helen Duncan est censée les puiser auprès des esprits de soldats défunts. Car elle est médium de son état et prétend donc entrer en contact avec les morts.
Au cours de séances de spiritisme dont elle est le centre, elle annonce ainsi le torpillage de navires britanniques. Des nouvelles qui s'avèrent exactes, et qui n'auraient jamais dû être divulguées.
En fait, Helen Duncan n'aurait pas dû faire l'objet d'une accusation de sorcellerie. En effet, les autorités avaient recours, en pareil cas, à une autre loi, dont le but était de protéger les justiciables des escroqueries des médiums.
Mais, en l'occurrence, Helen Duncan, qui ne faisait pas payer les services rendus, ne tombait guère sous le coup de cette loi. Si on avait retenu ce chef d'inculpation, elle aurait pu, en effet, être acquittée.
C'est pourquoi la justice préfère exhumer une vieille loi, datant du début du XVIIIe siècle, qui avait pour but de sanctionner les personnes prétendant pratiquer la sorcellerie.
Jugeant l'affaire très grave, les juges organisent le procès à l'Old Bailey, la principale Cour criminelle de Londres. Le 3 avril 1944, le tribunal reconnaît la culpabilité de la prévenue et la condamne à la prison.
Helen Duncan est donc la dernière personne, en Grande-Bretagne, à avoir été détenue pour sorcellerie. Le procès, dénoncé par certains, dont le Premier ministre, Churchill, sera très suivi par l'opinion publique.
Quant à Helen Duncan, elle sort très vite de prison, mais sans être graciée. Et elle continue ses activités de médium jusqu'à sa mort, en 1956.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 25 Mar 2024 - 2min - 1458 - Quel camp nazi fut déguisé en « paradis » ?
Même les nazis étaient parfois obligés de ménager les apparences. Pour éviter de passer, aux yeux du monde, pour des tortionnaires sans pitié, il leur arrivait de maquiller la vérité. Notamment à propos de leur politique génocidaire et d'un des lieux où elle était appliquée, les camps de concentration.
C'est ainsi qu'ils tentent de donner une image présentable de l'un de ces camps, Theresienstadt. Situé dans l'actuelle République tchèque, ce camp reçoit des déportés juifs venus de l'Europe entière.
Après un bref séjour, beaucoup sont transférés vers d'autres camps, comme Auschwitz. Mais Theresienstadt est aussi un camp d'extermination, où des dizaines de milliers de détenus sont morts de mauvais traitements ou de privations.
Les dirigeants nazis sont conscients de la nécessité de redorer le blason du IIIe Reich, souvent présenté comme un régime barbare. Ils rencontreront ainsi moins d'oppositions dans les pays qu'ils sont amenés à occuper.
Aussi ne s'opposent-ils pas à une demande du Danemark, visant à faire visiter le camp de Theresienstadt par une équipe de la Croix-Rouge. Mais ils demandent un délai.
Le temps de transformer cet enfer en un lieu accueillant. Un ancien acteur juif est chargé de recruter des figurants, bien nourris si possible. On construit une banque, un café et on prévoit même une scène de théâtre.
Les façades sont ravalées et des fleurs donnent à ce lieu de mort un aspect presque pimpant. Aussi, quand les délégués de la Croix-Rouge visitent le camp, en juin 1944, ils sont impressionnés par ce qu'ils voient.
Pari gagné pour les nazis qui décident, dans la foulée, de faire un documentaire sur ce "camp modèle". Connu sous le titre "le Führer offre une ville aux juifs", que lui donnent, par ironie, des rescapés du camp, le film montre les scènes tranquilles d'un lieu où il fait bon vivre.
Les magasins regorgent de produits, un concert est donné dans la rue et, dans un hôpital bien équipé, les malades reçoivent tous les soins nécessaires. Cet étonnant documentaire est devenu depuis l'un des meilleurs exemples des mystifications nazies.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 24 Mar 2024 - 2min - 1457 - Pourquoi Victor Hugo haïssait-il Napoléon III ?
Le célèbre auteur des "Misérables" et le prince Louis-Napoléon Bonaparte avaient pourtant tout pour s'entendre. Jusqu'à l'orée des années 1850, ils partagent en effet les mêmes convictions progressistes.
Après avoir été un fervent royaliste, dans sa jeunesse, Victor Hugo est en effet devenu le chantre de ce nous appellerions aujourd'hui la gauche. Homme politique aussi bien qu'écrivain, il est élu député, en 1848, et maire du 8e arrondissement de Paris.
Dans les journaux et à la tribune de l'Assemblée, il dénonce aussi bien la peine de mort que le sort des pauvres et le travail des enfants.
De son côté, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'Empereur, soutient les "carbonari", les memlbres d'une société secrète partisans de l'unification italienne et de l'instauration d'une Monarchie libérale.
Dans une brochure publiée en 1844, "De l'extinction du paupérisme", il réclame également le droit au travail et le droit d'association pour les ouvriers.
Aussi Victor Hugo soutient-il la candidature du prince aux élections présidentielles de décembre 1848. Mais, une fois élu, le nouveau Président va vite le décevoir.
En effet, il commence par restreindre le droit de vote et, lui qui avait pris fait et cause pour l'unité de l'Italie, envoie des soldats écraser la République romaine et restaurer le pouvoir du Pape.
Cette nouvelle provoque une journée révolutionnaire à Paris, réprimée par la troupe. À cette occasion, le Président menace les insurgés : il faut que "les méchants tremblent".
Et, le 2 décembre 1851, il franchit un pas qui lui vaudra l'opposition irréductible de Victor Hugo. Ce jour-là, en effet, il fait un coup d'État que tous considèrent, avec raison, comme le prélude à la restauration de l'Empire.
Dès lors, Victor Hugo prend le chemin de l'exil, d'abord en Belgique, puis à Jersey et Guernesey. Là, il ne cessera de fustiger celui qu'il n'appelle désormais que "Napoléon le Petit", titre de l'un des cinglants pamphlets qu'il écrira contre l'Empereur.
Celui qui avait proclamé qu'il ne reviendrait en France que "quand la liberté rentrera", ne regagne son pays qu'à la chute du Second Empire, en 1870.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 21 Mar 2024 - 2min - 1456 - Comment Henri III a-t-il été assassiné ?
Henri III a succédé à son frère Charles IX en 1574. Il règne dans un Royaume ravagé par les guerres de religion qui, depuis 1562, opposent catholiques et protestants.
Reprenant la politique inaugurée par sa mère, la Régente Catherine de Médicis, il essaie de trouver un juste milieu entre les protestants les plus radicaux et les catholiques intransigeants, souvent membres de la Ligue.
Or, le Roi mécontente ces derniers. Jugeant que le duc de Guise, qui dirige la Ligue, s'immisce par trop dans les affaires de l'État, il le fait assassiner en 1588.
N'ayant pas d'héritier, il reconnaît pour son successeur son cousin Henri de Navarre, le futur Henri IV. C'est un protestant, mais, en habile politique, il est prêt à faire des concessions. Selon son mot, "Paris vaut bien une messe".
Henri III est donc prêt à faire monter un protestant sur le trône de France. Aux yeux des ultra catholiques, c'est un reniement et même une véritable trahison.
C'est en tous cas ce que pense un certain Jacques Clément, un moine dominicain fanatique, qui prend très tôt parti pour la Ligue. Décidé à tuer Henri III, qu'il considère comme un renégat, il quitte Paris, le 31 juillet 1589, pour gagner Saint-Cloud, où se trouve le monarque. Henri III s'apprête à assiéger la capitale, dominée par les ligueurs.
Le moine parvient dans l'antichambre du Roi. Il insiste pour être reçu par le souverain. Il prétend apporter des nouvelles capitales en provenance de Paris. Sur son insistance, on le laisse entrer.
Le Roi le reçoit sans façons. Il est sur sa chaise percée. Même le majestueux Louis XIV ne dédaignait pas d'accueillir ainsi ses courtisans.
Jacques Clément s'approche du monarque, se penche un peu pour lui parler et, sortant un couteau de sa robe, en frappe le Roi au ventre. Celui-ci aurait arraché le poignard de son corps sanglant et, en frappant le moine au visage, se serait exclamé :"Méchant, tu m'as tué". Des gardes surgissent alors, lardent le religieux de coups d'épée et jettent son corps par la fenêtre.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 20 Mar 2024 - 2min - 1455 - Pourquoi le plus grand tombeau du monde est-il si mystérieux ?
On pourrait penser que les pyramides de Gizeh, en Égypte, et notamment la pyramide de Khéops, sont les plus grands tombeaux du monde. En termes de superficie, ce titre revient plutôt à une sépulture japonaise.
Il s'agit du Daisen Kofun, situé dans la ville de Sakai. Insérée dans le tissu urbain, cette nécropole ressemble à un immense trou de serrure. Elle se présente sous la forme d'un tertre recouvert de végétation, qui se dresse au centre d'un bassin rempli d'eau.
Long de 500 mètres et large de 300, cet impressionnant site funéraire, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, aurait une superficie d'environ 100.000 m2.
Le Daisen Kofun n'est pas un tombeau isolé. En effet, il fait partie du Kofungun de Mozu, un ensemble de 47 tumulus funéraires ("kofun," en japonais) situés dans la ville de Sakai. Cet immense site funéraire s'étendrait sur plus de 450.000 m2.
Ce type de tombes a été édifié, au Japon, du IIIe au VIIe siècle. De son côté, le Daisen Kofun a été construit au IVe siècle, peut-être avant. Il abriterait la sépulture de l'Empereur Nintoku, le 16e monarque de la lignée impériale.
On se doute que, sous ces monticules envahis par la végétation, dorment d'illustres personnages, et peut-être même certains des Empereurs légendaires qui auraient fondé la dynastie actuelle. On y trouverait aussi des quantités d'objets précieux.
Mais il est difficile de le vérifier, dans la mesure où l'accès de ces lieux est strictement interdit. Il en va ainsi, au Japon, de tous les sites impériaux. Même les archéologues n'ont pas le droit de s'y rendre.
Mais une équipe italienne a peut-être trouvé la parade. Ses chercheurs ont en effet étudié les images fournies par les satellites. Elles sont d'une grande précision, ce qui leur a permis de faire une découverte.
Ils ont en effet remarqué que ces sites étaient orientés de telle sorte que le soleil ou la lune en éclairaient toujours l'entrée. Ce qui n'est pas sans importance quand on sait que les Empereurs actuels prétendent toujours descendre d'Amaterasu, la déesse du Soleil.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 18 Mar 2024 - 2min - 1454 - Qui reçut le premier PV pour excès de vitesse ?
Pour écouter mes podcasts:
1/ Dans un lavabo, l’eau s’écoule-t-elle toujours dans le même sens ?
Apple Podcasts:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/7AQpMjrDi2WoSLm8orRmaj?si=922a9173b2274d40
2/ Quelle est la différence entre la tutelle et la curatelle ?
Apple Podcasts:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6ZTmV8hDFpCog9hrAyyrqF?si=250c9d3ec5444166
3/ Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire ?
Apple Podcasts:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/0J7DDFCJaSQL70LiTVrLkP?si=302773ddfd2948c1
4/ Pourquoi le Vatican est-il protégé par des gardes suisses ?
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492
Spotify:
https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3?si=3d75e97cfbb14681
-------------------------------------
Si vous prenez le volant, il vous est peut-être arrivé la désagréable surprise de recevoir, chez vous, une contravention pour excès de vitesse.
De telles sanctions sont aussi anciennes que l'automobile elle-même. Le premier à en être frappé est un Anglais du nom de Walter Arnold. Il ne roule pourtant pas vite, du moins selon nos standards actuels, lorsqu'il traverse la petite commune de Paddock Green, dans le Kent.
Mais il faut dire que nous sommes en 1896. La vitesse est alors limitée à un peu plus de 3 km/h en ville. Et notre chauffard, au volant de son Arnold Benz (une voiture de sa fabrication, sous brevet Benz), file à la vitesse folle de 13 km/h !
Il est arrêté par un policier à vélo, qui lui inflige une amende d'un shilling. Il lui indique alors que, non content de rouler trop vite, il n'est précédé d'aucun porteur de drapeau. Celui-ci devait en effet agiter un drapeau rouge, pour avertir les passants du danger. En ville, il doit marcher devant la voiture, d'où l'allure d'escargot imposée à celle-ci.
En France, la première contravention pour excès de vitesse frappe une femme. Il s'agit d'une personnalité haute en couleur, la duchesse d'Uzès. Passionnée d'automobile, cette aristocrate fortunée est la première femme à obtenir, en mai 1898, son certificat de capacité, l'ancêtre de notre permis de conduire.
En juillet de la même année, la duchesse est verbalisée au bois de Boulogne, en compagnie de son fils. Au volant de sa Delahaye type 1, elle roule à la vitesse de 15 km/h. Soit trois de plus que la vitesse autorisée en ville.
Sur une route de campagne, elle aurait pu lancer sa voiture jusqu'à 20 km/h. La duchesse d'Uzès paie l'amende, ce qui n'entame en rien son intérêt pour l'automobile. En 1926, en effet, elle prend une part active à la fondation de l'Automobile club féminin de France, cette illustre association n'acceptant pas les femmes à cette époque.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 17 Mar 2024 - 2min - 1453 - A quel vice Marie-Antoinette était-elle accro ?
L'image de Marie-Antoinette n'a cessé de se dégrader dans l'imaginaire collectif. On la dépeint souvent sous les traits d'une jeune femme frivole et écervelée, qui ne songerait qu'à s'amuser alors que la Monarchie court à l'abîme.
Et il est vrai que cette jeune archiduchesse d'Autriche, mariée à 14 ans, et délaissée par son mari, est rapidement la proie d'une Cour où les cabales vont bon train.
Une nouvelle biographie ajoute une touche de noirceur à ce portrait déjà bien chargé. À l'en croire, la Reine aurait été une inconditionnelle des jeux d'argent.
C'est sans doute faire un procès tendancieux à Marie-Antoinette que de l'accuser de s'être adonnée avec passion à ses jeux favoris. La chose n'est pas fausse, bien sûr. Mais il faut la replacer dans son contexte.
Depuis bien longtemps, en effet, les jeux de cartes étaient à la mode à la Cour de France. Les princes et les courtisans pariaient souvent de fortes sommes d'argent et d'autres Reines, avant Marie-Antoinette, sont connues pour leur amour du jeu.
Le soir venu, Marie-Antoinette s'adonnait aux jeux qui étaient à la mode à la fin du XVIIIe siècle. Elle appréciait le trictrac, un jeu de société, qui se jouait avec des cartes et des dés, ou le reversi, qui consiste à bien placer ses pions sur un échiquier.
Les loteries, comme le bingo ou le biribi, qui se jouaient avec des boules et des grilles, avaient aussi les faveurs de la Reine.
Et il est vrai que Marie-Antoinette jouait gros jeu. En effet, elle aurait dépensé quelque 180.000 livres en 1778, ce qui représente à peu près deux millions d'euros. La Reine était donc très dépensière et aurait dilapidé l'équivalent de plus de 20 millions d'euros.
Mais on ne peut pour autant l'accuser d'avoir contribué, à elle seule, à la faillite du pays. Il faut en effet comparer ses 180.000 livres de dépenses annuelles, en 1778, avec les 626 millions de livres de dépenses prévues par le premier budget de la Monarchie établi, en 1788, par le Contrôleur général des Finances Necker.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 14 Mar 2024 - 1min - 1452 - Pourquoi les avocats portent-ils une robe noire ?
Comme d'autres professions, les avocats revêtent un costume spécifique. Il se compose d'une robe noire, d'un rabat de couleur blanche, en coton, et d'une épitoge, deux brins de tissu portés sur l'épaule gauche. L'une de ces bandes pend sur la poitrine et l'autre dans le dos.
Ce costume, et notamment le port de la robe, n'est devenu une obligation, pour les avocats, que depuis une loi du 31 décembre 1971. Elle les oblige donc, comme d'autres corps de métier, à porter un uniforme, symbole de leurs fonctions.
Mais si la robe noire des avocats n'est devenue obligatoire que depuis une cinquantaine d'années, elle faisait partie de leur tenue depuis bien plus longtemps.
Cette longue robe noire, aux vastes manches, les avocats la doivent à leurs lointains devanciers. Sous l'Ancien Régime, en effet, la plupart des avocats étaient des clercs. Ils siégeaient notamment au Parlement de Paris, le plus haut degré de juridiction de l'époque, et dans les Parlements provinciaux.
Or, les prêtres portent alors une soutane, même si certains s'en dispensent. Cet habit, long et fermé, doit les distinguer des laïcs. Par bien des aspects, la robe de l'avocat ressemble à une soutane.
Il n'est pas jusqu'aux 33 boutons qui la ferment, en souvenir de l'âge du Christ au moment de sa mort, qui n'y fassent penser.
Si la robe d'avocat a conservé de son origine sa forme générale et sa teinte sombre, elle n'en a pas moins légèrement changé d'aspect. Ainsi, elle s'est raccourcie avec le temps, s'arrêtant aujourd'hui à mi-mollet. De même, si la traîne existe toujours, elle est rabattue à l'intérieur du vêtement.
Par souci de modestie, sans doute, et pour ne pas prêter le flanc à des critiques qui soulignent déjà le coût de la robe, compris entre 500 et 1.000 euros , parfois beaucoup plus.
Emblème de la fonction, et symbole de la justice, la robe ne doit être portée qu'au prétoire, ou dans de rares occasions, comme l'enterrement d'un collègue par exemple. L'avocat ne saurait donc l'arborer dans son cabinet ou dans la rue.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 13 Mar 2024 - 1min - 1451 - Comment Paris a-t-il été sauvé de la destruction en août 1944 ?
Après la percée d'Avranches, entre la fin juillet et la mi août 1944, les troupes alliées débarquées en Normandie, dont fait partie la 2e DB du général Leclerc, se dirigent vers Paris.
Dans le même temps, la police, la gendarmerie, la poste et les transports se mettent en grève. Des groupes armés se forment et, du 19 au 24 août, la capitale est le théâtre d'une véritable guérilla.
Gouverneur militaire du "Grand Paris", le général Dietrich von Choltiz doit défendre la ville. Mais, d'un point de vue militaire, la situation ne lui est pas favorable. C'est pourquoi, le 19 août, il accepte l'entremise du consul de Suède, Raoul Nordling, qui négocie un cessez-le-feu.
Trois jours plus tard, cependant, Hitler lui ordonne de détruire la ville. Si les Alliés entrent dans la capitale, ils doivent trouver un champ de ruines.
Des explosifs sont donc placés sous les ponts et auprès de nombreux bâtiments. Mais von Choltiz ne donne pas l'ordre de destruction et capitule le 25 août.
Dans les années qui suivent la guerre, le général von Choltiz se vantera d'avoir sciemment ignoré l'ordre d'Hitler. Il décrit le dictateur comme un homme épuisé qui, privé d'une partie de ses facultés, aurait pris une décision déraisonnable.
Pour de nombreux historiens, la vérité est sans doute différente. Il est normal que, dans le contexte de l'après guerre, von Choltiz ait voulu se donner le beau rôle. Mais aucun document ne vient appuyer ses dires.
En fait, il semblerait que cet officier qui, jusque là, avait toujours obéi aux ordres qu'on lui donnait, était bien disposé à faire exécuter celui-là. Simplement, il n'en eut pas le temps.
Par ailleurs, il n'avait pas suffisamment de troupes sous ses ordres. Au surplus, elles étaient médiocrement armées et devaient à la fois lutter contre l'insurrection parisienne et contre des troupes alliées attendues d'un instant à l'autre dans la capitale.
Enfin, von Choltiz savait que la bataille était perdue, et que, dans la perspective d'un probable jugement, après la guerre, il avait tout intérêt à soigner son image.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 11 Mar 2024 - 1min - 1450 - Pourquoi Marie-Angélique Duchemin est-elle célèbre ?
Marie-Angélique Duchemin est une pionnière, et ce à plusieurs titres. Née en 1772, elle épouse un caporal. Nous sommes en juillet 1789, au début de la Révolution. Comme c'est alors l'usage, cette toute jeune épouse suit son mari en campagne.
Il est vrai qu'elle a de qui tenir. Son père et son beau-frère sont aussi des soldats. Mais voilà que son mari meurt des blessures reçues au combat, le 30 décembre 1791.
Cette jeune veuve de 19 ans, pourtant déjà mère d'une petite fille, n'écoute que sa vocation : elle restera dans l'armée et y remplacera même son mari.
Personne ne trouve à y redire. Tout au contraire, puisque la jeune femme est même promue. En effet, elle devient caporal fourrier, et doit donc s'occuper de l'intendance. Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de prendre soin de ses enfants.
On le voit, l'armée de l'époque, transformée, il est vrai, par la tourmente révolutionnaire, ne s'opposait pas à la présence des femmes ni même à leur avancement.
Car Marie-Angélique Duchemin poursuit son ascension. Elle est en effet promue sergent major. Elle ne s'occupe pas seulement d'intendance, mais participe aux combats. C'est ainsi qu'elle s'illustre, en mai 1794, dans la défense du fort de Gesco, à Calvi. Elle y est grièvement blessée, ainsi qu'au siège de cette ville.
En 1798, alors qu'elle n'a que 26 ans, ses blessures lui valent d'être admise, avec le grade de sous-lieutenant, à l'hôtel des Invalides, construit par Louis XIV pour héberger les soldats blessés. C'est la première femme à y être accueillie.
Elle y restera d'ailleurs toute sa vie, s'occupant notamment du magasin d'habillement. En 1851, elle est la première femme à recevoir la légion d'honneur. Elle est élevée au grade de chevalier par le Prince-Président en personne, futur Napoléon III. Dans la citation qui accompagne la décoration, elle est d'ailleurs désignée comme "M. (et non Mme) Brûlon", son nom marital.
À cette occasion, elle obtient enfin ses épaulettes d'officier. Devenue très célèbre, Marie-Angélique Duchemin, toujours vêtue de son uniforme, meurt, en 1859, dans sa chambre des Invalides.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 10 Mar 2024 - 1min - 1449 - Qui était vraiment Surcouf ?
Le nom de Robert Surcouf est associé à la légende de la guerre de course. Avec Jean Bart et Jacques Lafitte, c'est sans doute l'un des plus célèbres corsaires de tous les temps.
Né en 1773, le futur écumeur des mers, destiné à la prêtrise par ses parents, s'engage comme mousse en 1786. Du fait des origines de sa famille, riche et considérée, il est plutôt traité comme un élève-officier.
Dès ses premiers voyages, il embarque sur des navires faisant la traite négrière. En 1789, l'un de ces vaisseaux fait naufrage, entraînant dans la mort 400 esclaves, enchaînés à fond de cale.
Surcouf reste un temps dans la marine marchande, puis entame, en 1792, une carrière dans la marine royale. Il n'y demeure pas longtemps, préférant se consacrer à la guerre de course.
De 1795 à 1801, à bord de plusieurs bateaux, Surcouf devient l'un des corsaires les plus célèbres et les plus réputés de son temps. Il ne dispose d'ailleurs pas toujours de la "lettre de marque", qui, en temps de guerre, autorise le capitaine d'un bateau à s'en prendre à des navires ennemis.
Cette absence de reconnaissance officielle le prive parfois d'une partie de ses prises. Il n'en sillonne pas moins les mers, organisant plusieurs expéditions vers l'Afrique ou l'océan Indien.
Durant ces quelques années, Surcouf s'empare de nombreux navires, dont le "Kent", en 1800. La prise de ce puissant vaisseau de 1.200 tonneaux et 40 canons assoit définitivement sa réputation. On va désormais l'appeler le "Tigre des mers".
Au total, Surcouf aurait amassé près de 500 millions de livres. Et gêné les Anglais, qui auraient voulu se protéger de ses assauts en équipant leurs vaisseaux de filets anti-abordage.
À partir de 1801, Surcouf devient un armateur prospère, tout en revenant de temps à autre, et jusqu'en 1809, à la guerre de course. À la tête d'une belle fortune, acquise en partie dans la traite des noirs, il achète des centaines d'hectares de terrain. Devenu un notable considéré, il meurt en 1827.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 07 Mar 2024 - 2min - 1448 - Quel rôle majeur Varian Fry a-t-il joué durant la Seconde Guerre mondiale ?
Né en 1907, le journaliste américain Varian Fry est connu pour avoir sauvé, durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux juifs réfugiés en France. Correspondant d'un journal américain à Berlin, il est témoin, en 1935, des violences que font subir aux juifs les nazis.
Il assiste alors à des scènes choquantes, qui vont le marquer durablement. En août 1940, il débarque à Marseille. Officiellement, il est là comme journaliste. En fait, il est mandaté par l'"Emergency rescue comity", un organisme de secours parrainé par Eleanor Roosevelt, l'épouse du Président américain.
Le but de ce comité est d'organiser la fuite vers les États-Unis des juifs menacés par les nazis, en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe.
En principe, la mission de sauvetage confiée a Varian Fry ne concerne pas tous les réfugiés juifs. En effet, il doit permettre à des intellectuels, des écrivains ou des artistes, de s'échapper vers l'Amérique.
Il arrive à Marseille avec une valise et une somme assez modeste en poche, environ 3.000 dollars. En principe, il est là pour trois mois, mais son séjour va durer plus d'un an.
Il reçoit l'aide d'un syndicat américain et de certaines organisations juives. Le vice-consul américain à Marseille lui est d'un grand secours, ainsi que la riche collectionneuse d'art Peggy Guggenheim, qui lui apporte un soutien financier appréciable.
Varian Fry fonde bientôt le Centre américain de secours (CAS), où une soixantaine de personnes viennent chaque jour demander de l'aide. Dans la vaste villa Air-Bel, située dans la banlieue de Marseille, se pressent des intellectuels renommés, pressés de quitter l'Europe.
On y côtoie en effet des poètes, comme Tristan Tzara ou Benjamin Perret, ou des artistes, comme André Masson, Max Ernst, Marcel Duchamp ou encore Marc Chagall.
Au total, plus de 2.000 personnes réussirent à fuir l'Europe grâce à l'intervention de Varian Fry. Le gouvernement de Vichy, qui appréciait peu ses activités, obtient son départ en septembre 1941.
Tardivement reconnue, son action lui vaut pourtant, à titre posthume, le titre de Juste parmi les nations.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 06 Mar 2024 - 2min - 1447 - Quelle est l’histoire de l'expression "veni vidi vici" ?
L'expression "veni, vidi, vici" fut prononcée par Jules César en 47 avant notre ère. Elle se compose de la première personne du parfait (souvent l'équivalent de notre passé composé) des verbes "venire", venir, "videre", voir, et "vincere", vaincre.
On la traduit généralement par "je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu". Cette expression frappe par sa concision. C'est ce laconisme qui lui a permis de passer à la postérité. Et aussi l'euphonie produite par ces trois mots à la terminaison semblable.
Cette expression est toujours employée pour désigner un succès éclatant. Elle implique en effet une notion de triomphe et de rapidité propre à subjuguer l'adversaire.
Cette célèbre phrase aurait été prononcée par César au cours d'un des épisodes de la guerre civile qui, de 49 à 45 avant J.-C., l'oppose à Pompée et à une partie du Sénat romain.
L'une des phases de ce conflit se déroule en Asie Mineure. En effet, Pharnace II, qui contrôle le royaume du Bosphore et une partie du royaume du Pont, qui s'est constitué sur le rivage méridional de la mer Noire, veut profiter de cette guerre civile pour récupérer des territoires perdus par son père.
Jules César accourt alors avec ses légions et affronte les troupes de Pharnace II à Zéla, en 47 avant notre ère. La bataille est un succès si net et si rapide qu'elle aurait incité César à prononcer sa fameuse apostrophe.
Pour certains auteurs latins, ce n'est pas sur le champ de bataille que César aurait dit : "veni, vidi, vici". Cette célèbre formule aurait été inscrite sur des panneaux lors du "triomphe" qui suivit la victoire de Zéla. Il s'agissait d'une cérémonie au cours de laquelle le général victorieux défilait dans les rues de Rome à la tête de ses troupes.
Cette phrase aurait également pu se retrouver dans le rapport envoyé au Sénat après la bataille. Elle aurait donc été écrite et ne serait pas sortie de la bouche même de César. Ce qui ne l'a pas empêchée de rester associée à son nom.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 04 Mar 2024 - 1min - 1446 - Qui est le Monstre de Florence ?
Par leur sauvagerie ou l'identité des victimes, certains crimes défraient la chronique. C'est notamment le cas de huit meurtres, commis, dans les environs de Florence, en Italie, entre 1968 et 1985.
Les victimes sont toujours des couples d'amoureux. D'où le nom de "tueur des amoureux" qu'on a d'abord donné au criminel. Puis on l'a surnommé le "Monstre de Florence". En raison de sa façon de s'acharner sur certaines de ses victimes.
S'il abat généralement les hommes de quelques coups de revolver, il tue les femmes avec une arme blanche, puis les mutile affreusement. Il a même coutume d'envoyer par la poste des parties de leurs corps, les seins notamment, aux magistrats de Florence.
L'identité des victimes, le mode opératoire et les armes utilisées ont convaincu les policiers qu'un seul criminel était sans doute à l'origine de cette série de meurtres. Toutefois, ils manquent de preuves et le "serial killer", s'il existe, court toujours.
La police a bien appréhendé une dizaine de suspects mais, faute de preuves convaincantes, ils ont fini par être libérés. C'est notamment le cas d'un ouvrier agricole du nom de Pietro Pacciani, qui avait assassiné l'amant de sa femme.
Lors de son premier procès, en 1994, il est reconnu coupable de sept des huit doubles meurtres attribués au "Monstre de Florence". Il est condamné à la prison à perpétuité. L'affaire semble alors résolue.
Mais, coup de théâtre, Pacciani est acquitté lors de son procès en appel, qui se tient deux ans plus tard. Sorti de prison, il meurt en 1998. S'il détenait un secret, il l'a emporté dans la tombe.
En étudiant cette affaire de plus près, les juges ont d'ailleurs conçu des doutes sur l'hypothèse d'un tueur en série. En effet, ils pensent que si Pietro Pacciani avait un rapport avec ces crimes horribles, il n'était pas le seul.
En effet, certains de ses amis, qui faisaient partie de sa bande habituelle, seraient impliqués eux aussi. Ce qui ne suffit pas à clarifier cette énigmatique affaire du "Monstre de Florence".
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 03 Mar 2024 - 1min - 1445 - Pourquoi le marquis de Sade a-t-il été emprisonné ?
Donatien Alphonse François de Sade, que nous connaissons sous le nom de marquis de Sade, est un écrivain renommé, connu notamment pour une œuvre emblématique, "Justine ou les malheurs de la vertu", qu'il rédige à la Bastille en 1787.
Mais si le nom de Sade est passé à la postérité, c'est davantage en raison des dérèglements de sa vie. Au point, d'ailleurs, d'avoir inspiré le mot "sadisme".
Ses livres, où la pornographie et la violence, sous toutes ses formes, ont la part belle, et sa vie, émaillée de scandales, lui ont valu de très nombreux séjours en prison. Il y a en effet passé 27 ans, sur les 74 que comporte sa vie.
En 1768, alors qu'il a 28 ans, Sade défraie une première fois la chronique. Il est accusé d'avoir suborné une veuve, puis de l'avoir entraînée dans une maison d'Arcueil, dans la région parisienne, où il lui aurait fait subir divers sévices.
Le scandale éclate et le marquis, protégé par sa famille, n'écope que d'une peine d'emprisonnement de quelques mois, au château de Saumur.
Mais quatre plus tard, en 1772, alors qu'il séjourne à Marseille, il fait encore parler de lui. La rumeur l'accuse de s'être livré, en compagnie d'un valet de cinq jeunes filles, à diverses débauches, dont la sodomie, alors passible de la peine capitale.
Et, de fait, il est condamné à mort par le Parlement de Provence. Mais il échappe à la justice en s'enfuyant en Italie, en compagnie d'une belle-sœur dont il fait sa maîtresse. Il est alors arrêté sur l'ordre du duc de Savoie et incarcéré au fort de Miolans, dans l'actuel département de la Savoie.
D'autres prisons suivront. En effet, Sade est emprisonné au donjon de Vincennes, en 1777, puis à la prison royale d'Aix. Son procès n'aboutira qu'au paiement d'une modeste amende.
Mais il retourne à Vincennes, avant d'être transféré à la Bastille, en 1784. En juillet 1789, peu avant la prise de la Bastille, Sade est transporté à Charenton, dans un hospice pour aliénés mentaux, où il finira sa vie en 1814.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 29 Feb 2024 - 1min - 1444 - Pourquoi les juges anglais portent-ils des perruques ?
On n'imagine pas plus un juge anglais sans perruque qu'un "bobby" sans son casque arrondi. Les magistrats ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'en coiffer ; les avocats en portent une aussi.
L'usage s'en est imposé à la fin du XVIIe siècle. On adopte alors, pour les tribunaux, un code vestimentaire comprenant également l'adoption d'une robe, agrémentée de détails décoratifs, comme un jabot de dentelles pour certains magistrats.
Il s'agissait d'imposer aux hommes de loi anglais une tenue correcte, qui les distingue en même temps de celle de leurs concitoyens. Elle devenait donc l'emblème de leur profession.
Les perruques et les robes des magistrats sont toujours portées, du moins dans certains procès. Faites en crin de cheval, les perruques des avocats sont plus courtes que celles des juges.
La forme du haut de la coiffe, ainsi que le nombre et l'aspect des boucles qui en composent l'arrière, sont codifiés avec une grande précision. Il est à signaler que cet usage de la perruque, pour les juges et avocats, a été repris par de nombreux pays du Commonwealth.
Certains magistrats contestent cependant le port de la perruque. Ils la trouvent inconfortable, surtout en été. Et ils estiment cet usage désuet et peu conforme aux habitudes vestimentaires de leur époque.
Mais les partisans de la perruque ne manquent pas. On sait que les Anglais ne goûtent guère les changements trop rapides. Pour beaucoup d'entre eux, le maintien des traditions est le meilleur moyen de préserver l'originalité de leur culture.
Par ailleurs, la perruque est vue comme l'une des pièces d'un uniforme. Comme tout uniforme, il favorise une certaine forme d'anonymat, garantie de neutralité. Enfin, cette tenue, dont fait partie la perruque, symbolise l'autorité même de la loi.
Des arguments qui n'ont pas entièrement convaincu le Lord Chief Justice, le juge le plus haut placé dans la hiérarchie judiciaire britannique. En 2007, en effet, il décide, à la suite d'une requête portée devant les tribunaux, de réserver le port de la perruque aux seuls procès criminels.
Dans les affaires civiles, juges et avocats peuvent désormais paraître dans le prétoire sans arborer ce couvre-chef.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 28 Feb 2024 - 2min - 1443 - Pourquoi Louis XIV paraissait-il plus grand qu'il n'était en réalité ?
Les Rois de France étaient des personnages publics, dont les moindres gestes étaient scrutés par les courtisans. On peut donc penser qu'on n'ignore aucun détail de leur vie.
Et pourtant, bien des éléments échappent aux historiens. Ainsi, on ne connaît pas avec certitude la taille d'un Roi aussi célèbre que Louis XIV, qui avait pourtant fait de son existence un spectacle permanent.
On a longtemps prétendu qu'il était plutôt petit, du moins pour nous. Il n'aurait pas dépassé 1,65 m, ou un peu plus, ce qui correspondait d'ailleurs à une taille moyenne pour l'époque.
L'un des arguments invoqués est la petite taille des lits où dormait l'illustre monarque. Mais rappelons qu'à cette époque les nobles dormaient en position demi assise, la position couchée étant réservée aux malades.
Par ailleurs, l'apparence de certains des vêtements qu'aurait portés le Roi témoigne plutôt en faveur d'une grande taille. Dans une récente biographie, un historien prétend même que Louis XIV mesurait 1,84 m.
Ce qui une très haute taille pour l'époque. Sauf si l'on tenait compte, dans ces mensurations, de la perruque et des talons. En effet, le souverain arborait une haute perruque, dite "à la royale", qui pouvait atteindre 15 centimètres.
Et il portait des talons qui avaient 10 à 12 centimètres de hauteur. Ces talons de bois, recouverts de cuir rouge, étaient alors à la mode chez les grands. La taille du Roi était donc rehaussée de 20 à 25 centimètres supplémentaires.
Si on les ajoute à la taille qu'on lui attribue souvent (1,65 m), on arrive à 1,85-1,90 m. Et si Louis XIV avait mesuré 1,84 m sans sa perruque et ses talons, il serait alors apparu, aux yeux de ses courtisans, comme un véritable géant de plus de 2 mètres !
Il est vrai qu'à cet égard, les témoignages divergent. Si Mme de Motteville, dame d'honneur d'Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, donnait au Roi une tête de plus qu'à Mazarin, pourtant assez grand, la Palatine, la belle-sœur du Roi, qui le voyait tous les jours, le trouvait trop petit.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 26 Feb 2024 - 1min - 1442 - Pourquoi certaines femmes sont appelées des "tricoteuses" durant la Révolution française ?
D'une certaine manière, la Révolution française peut être considérée comme une période d'émancipation pour les femmes, dont certaines ont pu jouer un rôle plus notable dans la société de leur temps.
C'est notamment le cas de celles que l'Histoire a retenues sous le nom de "tricoteuses". Ce sont le plus souvent des femmes du peuple, qui prennent l'habitude d'assister aux séances des assemblées révolutionnaires. Elles manquent rarement celles de la Convention nationale, qui se réunit à partir de septembre 1792.
Les séances étant publiques, elles s'installent dans les tribunes. Pour s'occuper, entre deux discours, et ne pas perdre leur temps, elles emportent leur ouvrage. On les voit alors sortir leurs aiguilles à tricoter et se lancer dans la confection de quelque lainage. D'où le surnom qui leur est resté.
Les tricoteuses n'ont pas très bonne réputation. Elles sont souvent considérées comme de véritables mégères, promptes à la violence. Du haut de la tribune, elles n'hésitent pas à apostropher les orateurs qu'elles trouvent trop mous ou trop indulgents.
Certaines se sentent mandatées par leurs concitoyens pour veiller à une application rigoureuse des lois. On les voit aussi, dans la littérature notamment, comme des harpies ivres de sang.
Car elles ne sont pas seulement présentes aux sessions de la Convention et aux séances des nombreux clubs qui s'ouvrent alors dans la capitale. Elles sont aussi très actives au tribunal révolutionnaire qui, sous la Terreur, envoie des milliers de condamnés à la guillotine.
L'accusateur public, le célèbre Fouquier-Tinville, n'est pourtant pas connu pour sa mansuétude. Mais les tricoteuses sont là, dans le public, toujours prêtes à intervenir si, malgré sa réputation de férocité, il se laissait aller à une coupable indulgence.
Mais si la postérité a fait de ces femmes des viragos altérées de vengeance, c'est surtout en raison de la présence de certaines d'entre elles au pied de l'échafaud. On les disait en effet très friandes du spectacle sanguinaire qui s'offrait alors à leurs yeux.
Bien entendu, une telle caricature ne reflète qu'en partie une réalité plus nuancée.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 25 Feb 2024 - 1min - 1441 - Pourquoi le mur de Berlin est-il tombé précisément le 9 novembre 1989 ?
REDIFFUSION
La date du 9 novembre 1989 est restée dans l'Histoire comme celle de la chute du Mur de Berlin. Mais pourquoi cette ouverture de la frontière entre les deux secteurs de Berlin, dont les répercussions seront considérables, s'est-elle faite précisément ce jour-là ?
Pour le comprendre, il faut rappeler que la contestation ne cessait d'enfler en RDA, où d'imposantes manifestations avaient lieu depuis le mois d'octobre. Egon Krenz venait même de remplacer, à la tête du pays, Erich Honecker, au pouvoir depuis 28 ans.
C'est dans ce contexte que, le 9 novembre 1989, en fin de matinée, des mesures de libéralisation des voyages sont annoncées aux instances du parti communiste est-allemand. En satisfaisant l'une des revendications exprimées par les manifestants, on espérait faire retomber la tension.
En fin d'après-midi, ce même 9 novembre, le porte-parole du parti annonce à la presse les dernières mesures prises. Dans un premier temps, il n'évoque pas la décision de faciliter les voyages vers l'ouest.
Puis il y fait allusion en donnant lecture d'un document traitant des visas nécessaires aussi bien pour voyager que pour émigrer hors du pays. Et il précise que ces visas seront accordés "sans conditions".
Cette nouvelle fait sensation. En effet, jusque-là, obtenir un tel visa relevait du parcours du combattant. C'est alors qu'un journaliste demande quand cette mesure doit s'appliquer.
Le porte-parole ne semblait pas s'attendre à une telle question. Il lance alors : "mais...tout de suite !". Cette nouvelle sensationnelle est aussitôt répercutée par les médias occidentaux.
Aussitôt la rumeur se répand. Les Allemands de l'Est se rendent en masse au point de passage de Bornholmer Strasse, entre les deux secteurs de Berlin. Alors que la presse de l'ouest annonce, avec un peu d'avance, que le Mur est ouvert, la foule réclame, à grands cris, qu'on ouvre la porte du poste-frontière.
Les gardes sont décontenancés. Visiblement, ils n'ont reçu aucune instruction sur ce qu'il convient de faire. Après des heures d'hésitation, un officier donne finalement l'ordre de laisser passer les gens. Le Mur de Berlin vient de tomber.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 22 Feb 2024 - 1min - 1440 - Quel Viking est à l'origine de la Normandie ?
REDIFFUSION
Les livres d'Histoire l'apprennent aux écoliers : Le Viking Rollon serait à l'origine de la région que nous appelons toujours la Normandie. C'est donc un Viking, ou un "Normand", autrement dit un "homme du nord".
Rollon s'inscrit dans ce vaste mouvement de peuples que sont les incursions vikings. Depuis la fin du VIIIe siècle, ces rudes guerriers, venus notamment des pays scandinaves, ravagent la France actuelle et d'autres contrées.
Dans un premier temps, ils ne cherchent pas à s'installer durablement sur les terres où ils déferlent. Ce qui les intéresse, ce sont les richesses qu'elles renferment. Ils organisent donc des raids de pillage, dévastant tout sur leur passage, puis ils se retirent sur leurs bases de départ.
Rollon est donc l'un de ces redoutables Vikings. Il serait né à la fin des années 840. Son origine est encore très discutée. Selon les sagas nordiques qui retracent son parcours, il viendrait du Danemark ou de Norvège.
D'autres sources le font naître dans les Orcades, des îles situées au bord de l'Écosse. Quoi qu'il en soit, Rollon devient le chef d'un groupe de guerriers vikings, qui saccagent les côtes de la Manche et de la mer du Nord.
Le temps passant, ils pénètrent, en passant par la Seine, au cœur du territoire de la France actuelle. Ils s'installent à l'embouchure du fleuve et parviennent même jusqu'à Paris, qu'ils assiègent, avec d'autres bandes, en 885-887.
Or, la "Francia", ou "Francie occidentale", issue du partage de l'Empire carolingien, est alors très divisée. Et elle doit faire face, en plus des incursions des Vikings, aux invasions des Sarrasins, au sud, et des Avars et des Hongrois, à l'est.
Dans ces conditions, le petit-fils de Charlemagne, Charles le Simple, Roi de Francie occidentale (l'ancêtre de la France actuelle) préfère s'entendre avec les Vikings.
En 911, il conclut donc le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec Rollon. Il lui concède un territoire, autour du comté de Rouen, qui donnera naissance à la Normandie. Et Rollon lui-même en sera le premier duc.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 21 Feb 2024 - 1min - 1439 - Quel massacre fut commis par les américains au Vietnam ?
REDIFFUSION
Il est bien rare que, dans un conflit, les lois de la guerre soient toujours respectées. La guerre du Vietnam n'échappe pas à la règle. Elle connut en effet un affreux carnage, le massacre de My lai.
My Lai est un paisible village. Quand des soldats américains l'investissent, le 16 mars 1968, il n'est peuplé que de vieillards, de femmes et d'enfants. Pourtant, la section du lieutenant William Calley croyait y trouver des Viet-Congs.
C'est alors que les soldats, sur l'ordre de leur chef, entreprennent une tuerie méthodique. À coups de fusil, ou de baïonnette, ils massacrent sans pitié les femmes et les enfants qu'ils trouvent.
Certains soldats refusent cependant de participer au massacre. Un officier, arrivé sur les lieux en hélicoptère, ordonne même de faire feu sur les criminels. Malgré tout, entre 350 et 500 habitants sont sauvagement assassinés.
Comment des soldats ont-ils pu en arriver à un tel degré de barbarie ? Certains l'expliquent par les lourdes pertes essuyées par la compagnie dont l'une des sections a perpétré le massacre.
En quelques mois, elle aurait perdu la moitié de ses effectifs. En outre, dans cette guérilla où tous les coups sont permis, les soldats sautent sur des mines ou tombent dans les pièges tendus par l'ennemi.
Les GIs auraient donc été ivres de vengeance. Ils ne trouvent pourtant pas grâce auprès de l'opinion publique et des médias, pour qui ce massacre est un véritable choc et un tournant dans la guerre du Vietnam.
Consciente du scandale et de la colère de l'opinion, l'armée crée une commission d'enquête en septembre 1969. Une vingtaine de personnes sont inculpées, dont le lieutenant Calley et le capitaine Medina, qui commandait la compagnie.
Pourtant, seul Calley est condamné à la réclusion à perpétuité. Personne d'autre n'est inquiété. Devant cette unique condamnation, les journaux crient à la parodie de justice.
Le président Nixon, soucieux de minimiser le massacre, fera d'ailleurs bénéficier l'officier d'une mesure de libération conditionnelle, s'efforçant par ailleurs de discréditer les personnes ayant porté l'événement sur le devant de la scène.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 19 Feb 2024 - 1min - 1438 - Quelle fut la première grève de l'histoire ?
REDIFFUSION
Les réactions face à l'actuel projet de réforme des retraites vient encore le rappeler : la grève est l'un des principaux moyens de contestation dans notre pays. Depuis la Révolution française, notamment, elle ponctue l'histoire des revendications sociales et du mouvement ouvrier.
Mais la grève, qui n'est pas l'apanage de la France, n'est pas non plus cantonnée à l'histoire contemporaine. En effet, c'est un phénomène qui remonte beaucoup plus haut dans le temps.
Et les historiens ont même identifié la grève la plus ancienne. Elle aurait eu lieu en Égypte, 2.100 ans avant notre ère ! Nous sommes à Thèbes, sur la rive orientale du Nil.
Les serviteurs d'un temple de cette ville arrêtent de travailler et exposent leurs revendications au gouverneur. Ils ne reprendront pas le travail tant qu'on ne leur distribuera pas deux galettes supplémentaires par jour.
L'Égypte ancienne est décidément le lieu de naissance de la grève, conçue comme un moyen de pression pour obtenir la satisfaction de ses revendications. Ainsi, en 1166 avant J.-C., un papyrus rend compte, pour la première fois, de l'un de ces mouvements sociaux.
Il concerne les artisans et les ouvriers qui édifient les tombeaux des pharaons dans la Vallée des Rois, une région située sur la rive occidentale du Nil, en face de Thèbes.
Les artisans réclament leur salaire, qui ne leur a pas été payé, et se plaignent de manquer de nourriture. Ils cessent donc le travail pour réclamer une amélioration de leur situation.
La grève a ensuite atteint d'autres contrées, comme la Grèce classique. C'est du moins ce que laisse supposer Aristophane qui, dans sa comédie "Lysistrata", écrite au Ve siècle avant J.-C., met en scène des femmes qui, pour contraindre les hommes à cesser la guerre, refusent de coucher avec eux.
Il s'agit là d'une forme de grève assez originale. Plus classique, en revanche, la grève qui éclate en France, en 1229, quand, à la suite de la répression violente d'une rixe, qui se traduit par la mort de nombreux étudiants, ces derniers décident de boycotter les cours de l'Université de Paris.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 18 Feb 2024 - 2min - 1437 - Qui est le vrai d'Artagnan ?
Qui ne connaît d'Artagnan, le fringant gascon mis en scène par Alexandre Dumas dans son célèbre roman "Les trois mousquetaires" ? Mais, ce qu'on sait moins, c'est que ce valeureux soldat a bel et bien existé.
Il est né, vers 1615, au château de Castelmore, sur le territoire de la petite commune de Lupiac, dans le Gers. Le visiteur se promenant dans la région peut encore apercevoir le manoir qui, hélas, ne se visite pas.
Le héros de Dumas se nommait Charles de Batz de Castelmore, mais se faisait appeler d'Artagnan, du nom d'une seigneurie possédée par les Montesquiou, la famille de sa mère. La famille paternelle, assez modeste, était de noblesse récente.
Le jeune d'Artagnan monte à Paris, vers 1630, pour y faire, comme certains de ses frères, une carrière militaire. Il y est d'abord engagé dans le régiment des Gardes Françaises qui, comme son nom l'indique, était chargé d'assurer la sécurité du Roi.
Puis, comme dans le roman, il intègre le corps d'élite des mousquetaires, créé en 1622 par Louis XIII. Peu à peu, d'Artagnan va devenir un collaborateur apprécié du cardinal Mazarin, auquel il reste fidèle durant la Fronde, puis de Louis XIV.
Il se voit alors attribuer des missions de confiance. Promu, en 1658, au commandement effectif des mousquetaires, supprimés un temps par Mazarin, d'Artagnan est en effet chargé, en 1661, d'arrêter, dans le plus grand secret, le surintendant Fouquet, dont l'ascension et la munificence avaient indisposé le Roi.
C'est lui qui conduit l'illustre prisonnier vers ses divers lieux de détention, dont la forteresse de Pignerol, aujourd'hui en Italie. Marque insigne de faveur, d'Artagnan devient le geôlier de Fouquet durant trois ans.
En 1660, il avait déjà accompagné Louis XIV vers le Pays Basque, où il devait épouser l'Infante d'Espagne Marie-Thérèse. Il était désormais un homme riche et considéré, qui possédait un hôtel particulier à Paris.
C'est en participant au siège de Maastricht, en 1673, lors de la guerre de Hollande, que d'Artagnan est fauché par un tir de mousquet qui le tue sur le coup.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 15 Feb 2024 - 1min - 1436 - Pourquoi y a-t-il une abbaye au Mont St Michel ?
Ceint de remparts et couronné, à son sommet, d'une abbaye aux allures de château-fort, l'îlot formé par le Mont Saint-Michel est l'un des monuments les plus visités de France. Appelé mont Tombe dans l'Antiquité, il fut peut-être le cadre d'un culte druidique ou de celui rendu à Bélénos, le dieu gaulois du soleil.
Au haut Moyen-Âge, l'endroit fut peu à peu consacré à l'archange saint Michel, dont le culte se répand en Occident à partir du Ve siècle. D'après une légende, l'archange serait apparu, par trois fois, à saint Aubert, évêque d'Avranches, lui ordonnant de construire un sanctuaire sur le mont Tombe.
Obéissant aux instructions de saint Michel, l'évêque aurait fait bâtir un oratoire en 708. Il y aurait fait placer des reliques de l'archange, qu'il aurait fait rapporter d'Italie.
Mais la "Merveille" que les visiteurs découvrent aujourd'hui, cette prestigieuse abbaye inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, a été bâtie plus tard.
On doit sa construction à des moines bénédictins, qui s'installent, à la fin du Xe siècle, sur ce qui allait devenir le mont Saint-Michel. Les bâtiments de cet ensemble roman commencent à s'élever à partir de 1023, ce qui a permis de commémorer, l'année dernière, le millénaire de l'abbaye. Les travaux de construction sont achevés en 1228.
Le choix de ce lieu prestigieux n'était pas anodin. Il devait contribuer au prestige de l'abbatiale, en attirant notamment le flot de pèlerins venus se mettre sous la protection de l'archange saint Michel.
Comme tous les monastères médiévaux, l'abbaye du Mont Saint-Michel devint un conservatoire de la culture. Gardés dans ses murs, des centaines de précieux manuscrits passèrent ainsi à la postérité.
En plus des pèlerins ordinaires, l'abbaye ne manqua jamais d'accueillir d'illustres visiteurs, comme saint Louis, François Ier ou Louis XI.
Des débuts de la Révolution française à 1863, l'abbaye sert de prison. Après sa fermeture, le site est restauré peu à peu, une route étant même construite pour relier le mont à la terre ferme. Rendue au culte en 1922, l'abbaye abrite à nouveau une communauté monastique.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 14 Feb 2024 - 2min - 1435 - Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ?
La plupart des spécialistes situent la mort de Jésus Christ entre l'an 30 et l'an 33 de notre ère. Ils pensent aussi qu'elle a eu lieu en avril, au moment de la Pâque juive.
Le châtiment qui lui a été infligé est celui de la crucifixion. Pour les Romains, il s'agissait d'une peine infamante, destinée à punir les esclaves en fuite ou tous ceux qui remettaient en cause l'ordre établi.
Les poignets et les pieds du condamné étaient cloués, ou attachés par des cordes, à deux poutres formant une croix. Celle-ci une fois redressée, le supplicié finissait, du fait de sa position, par mourir asphyxié.
D'après les Évangiles, Jésus aurait été dénoncé par les autorités religieuses juives au procurateur de Judée, Ponce Pilate, qui, entre 26 et 36 de notre ère, représente l'autorité romaine dans la région.
Sachant qu'il ne serait pas sensible à des accusations d'ordre religieux, qui ne concernent pas le pouvoir romain, les grands prêtres juifs évoquent des motifs politiques.
À l'instar des autres messies qui, avant l'apparition de Jésus, avaient troublé la région, le Christ revendique en effet la royauté, même s'il précise à ses disciples qu'elle "n'est pas de ce monde".
Par ailleurs, il mobilise des foules, ce qui peut le faire passer, aux yeux des Romains, pour un agitateur politique. Il n'en faut pas plus pour voir en ce "roi des juifs", des mots inscrits sur sa croix, une menace pour Rome. On le soupçonne en effet de vouloir rétablir une royauté supprimée par les Romains en l'an 6 de notre ère.
Les prêtres juifs voulaient donc la mort de Jésus, et seul le procurateur romain avait le droit de la lui infliger. Mais, eux, ils la désiraient pour des raisons religieuses.
En effet, ils comptaient se débarrasser de ce prophète qui, tout en restant fidèle à la Loi de Moïse, voulait assouplir certaines de ses prescriptions, comme le respect du sabbat. Et ils le tenaient aussi pour un idolâtre, qui n'hésitait pas à se proclamer fils de Dieu, un blasphème intolérable pour les juifs.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 12 Feb 2024 - 1min - 1434 - Montaigne a-t-il inventé l'effet placebo ?
Un malade soigné avec un produit neutre, de l'eau sucrée par exemple, et dont l'état s'améliore, bénéficie de ce qu'on appelle l'"effet placebo".
Le terme "placebo" a d'abord un sens religieux. Tiré du latin, et signifiant "je plairai", on le trouve dans le psaume 116, qui est lui-même inclus dans la Bible. Chanté lors de l'office des morts, ce psaume était entonné par des pleureurs et pleureuses recrutés pour l'occasion.
Sachant que de tels sanglots étaient simulés, on a fini par associer le mot "placebo" à une idée de fausseté mêlée de flagornerie, les pleureuses devant faire preuve de zèle pour se montrer convaincantes.
Peu à peu, le terme en viendra à s'appliquer à des patients que la seule vue du médecin, et la confiance qu'ils lui portent, suffit à guérir.
Avant même que le terme ne soit consacré par la littérature médicale, Montaigne donne déjà, dans ses célèbres "Essais", écrits au XVIe siècle, des exemples de l'effet placebo.
L'écrivain cite ainsi le cas d'un homme souffrant de calculs rénaux, une affection qu'on nommait alors la "maladie de la pierre". Il appelle donc un apothicaire à son chevet, qui lui prescrit des lavements.
Voilà donc notre malade couché et en position de recevoir ce que la médecine du temps appelait un "clystère". Mais le médecin se contente de faire semblant, n'injectant aucun produit dans son organisme.
Ce qui n'empêche pas le patient de se sentir mieux. Et Montaigne de conclure : "il en sentait pareil effet à ceux qui le prennent". Bien sûr, il n'emploie pas les termes "placebo" ou "effet placebo", mais il en offre déjà une parfaite définition.
L'écrivain évoque aussi le cas d'une femme qui, croyant avoir avalé une épingle, ressentait une vive douleur à la gorge. Un de ses amis, ne décelant aucune trace d'enflure, la fait vomir et jette discrètement une épingle dans la cuvette.
À sa vue, la femme se sent aussitôt soulagée. C'était, là encore, faire déjà la preuve du pouvoir de l'imagination et de l'origine psychosomatique de bien de nos maux.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 11 Feb 2024 - 1min - 1433 - Je vous parle de mon nouveau podcast: La folle épopée
Pour écouter La folle épopée:
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/la-folle-%C3%A9pop%C3%A9e/id1727649957
Spotify:
https://open.spotify.com/show/74el11FIusukqlTkEMPstj
Deezer:
https://deezer.com/show/1000659242
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sat, 10 Feb 2024 - 1min - 1432 - Le sein de Marie Antoinette est-il à l'origine de la coupe de champagne ?
Les fêtes de fin d'année sont toujours l'occasion, du moins en France, de boire du champagne. Ce vin prestigieux se déguste dans des coupes, dont la forme évasée permet une bonne oxygénation du champagne, ou dans des flûtes, qui mettent mieux en valeur la mousse et les bulles, inséparables de ce délectable nectar.
Mais d'où vient la forme particulière de la coupe de champagne, qui semble moins appréciée aujourd'hui ? Une légende tenace l'attribue au moulage qu'on aurait fait d'un sein de la Reine Marie-Antoinette. Il est vrai qu'on ne prête qu'aux riches et qu'on a créé de nombreux mythes, souvent peu favorables à son image, autour de cette souveraine.
La poitrine d'autres femmes, comme la marquise de Pompadour, maîtresse de Louis XV, l'Impératrice Joséphine ou Diane de Poitiers, la favorite d'Henri II, aurait pu inspirer la forme de ce verre. Mais il ne s'agit, là encore, que de rumeurs, qui n'ont aucun fondement historique avéré.
La symbolique du sein nourricier, pourvoyeur de lait, n'est sans doute pas sans rapport avec la diffusion de ces plaisantes histoires.
Mais il est pourtant une femme, dont le sein a bien inspiré la forme d'une coupe de champagne. Il s'agit du mannequin britannique Kate Moss, dont le sein gauche a bien été moulé par une sculptrice qui, à partir de ce moulage, a créé une coupe de champagne.
La véritable origine de la coupe de champagne serait plutôt à rechercher du côté de l'Angleterre. On sait que les Anglais ont toujours été friands de champagne.
Pour mieux le déguster, ils auraient créé un verre à la forme évasée, qui n'est pas sans évoquer celle du calice, un vase sacré destiné à contenir le vin utilisé lors de l'Eucharistie, durant une messe catholique.
Pour certains, les Anglais seraient d'ailleurs aussi à l'origine de la flûte, qui apparaît au milieu du XVIIIe siècle et finira, dès les années 1930, par supplanter la coupe. Il est cependant à noter que les amateurs préfèrent encore le verre tulipe, légèrement évasé.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 08 Feb 2024 - 1min - 1431 - Quel fut le premier billet de banque ?
Dans tous les pays, les moyens de paiement sont en partie composés de pièces et de billets de banque. Du fait de la matière avec laquelle ils sont fabriqués, ces derniers constituent ce qu'on appelle la "monnaie-papier".
La valeur de ces titres de paiement résultant en grande partie de la confiance que leur portent les utilisateurs, on parle aussi de monnaie "fiduciaire", le mot venant du latin "fiducia", qui veut dire "confiance".
L'ancêtre du billet de banque nous vient probablement de Chine. Il fut créé sous la dynastie Tang, vers la fin du Xe siècle, dans la province chinoise du Sichuan.
Ces premiers billets portent le nom de "jiaozis", ce qui signifie "change". En effet, ce système s'apparentait à celui des lettres de change, des effets de commerce grâce auxquels un créancier peut réclamer au débiteur le paiement de l'argent dû.
Les "jiaozis" avaient été précédés, vers le VIIIe siècle, par une autre forme de billets, appelés "monnaies volantes". Mais, contrairement aux "jiaozis", ils n'avaient pas cours légal.
L'introduction de ces premiers billets de banque, à valeur fixe, était apparue aux négociants chinois comme une nécessité. En effet, ils devaient, pour assurer leurs transactions, transporter de grandes quantités de pièces en fer très lourdes.
Ils trouvèrent plus pratique de confier cette monnaie métallique à des représentants du pouvoir qui, en échange, leur remettaient des sortes de bons, attestant du dépôt remis entre leurs mains.
Les "jiaozis" se présentaient comme des feuillets roses, sur lesquels des idéogrammes et des motifs animaux et végétaux étaient imprimés à l'encre noire. L'apposition de sceaux officiels attestait de la valeur de ces billets.
Le problème récurrent de cette monnaie-papier est qu'on eut rapidement tendance à en émettre davantage que les pièces ou les lingots de métaux précieux qui garantissent leur valeur.
C'est d'ailleurs ce qui se passa aussi à l'occasion de la première émission de billets de banque européenne, qui eut lieu en Suède, au milieu du XVIIe siècle. Elle vit également l'instauration de la première banque centrale, qui reçut le monopole de l'émission de ces billets.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 07 Feb 2024 - 1min - 1430 - Quel était l'état des dents des Vikings ?
Pour écouter ce podcast via:
Apple Podcasts:
https://itunes.apple.com/fr/podcast/les-dessous-de-lhistoire/id1408994486?l=en&mt=2
Spotify:
https://open.spotify.com/show/3fzY4N4YOJ9nQvcArB6xE8
Deezer:
https://www.deezer.com/fr/show/58035
---------------------
Lors de fouilles menées sur le site suédois de Varnhem, en Suède, une équipe de chercheurs a trouvé un véritable cimetière viking. Du fait de la nature du sol, les squelettes découverts étaient en très bon état.
Sur les 171 qui ont ou être mis au jour, on a prélevé près de 3.300 dents. C'était l'occasion rêvée d'examiner de plus près la dentition de ces redoutables guerriers.
L'imagerie traditionnelle les voit comme des gens assez frustes, qui ne devaient guère se préoccuper de l'état de leurs dents. Or, les radios et les divers examens pratiqués par ces scientifiques suédois montrent qu'ils les entretenaient, même si ces soins n'étaient pas toujours efficaces.
D'après l'étude publiée par cette équipe de chercheurs, on constate d'abord que la dentition des enfants ne présentait pas de traces de caries. De même, les Vikings les plus âgés souffraient plus rarement de ce type d'infection. Ce qui peut s'expliquer simplement par la perte des dents les plus endommagées.
En dehors des enfants et des vieillards, ces rudes combattants avaient souvent des dents cariées. En effet, c'était le cas de plus de 60 % d'entre eux. Et ces caries, attaquant souvent la dent jusqu'à la racine, devaient être très douloureuses.
La consommation régulière d'aliments contenant des sucres, comme les fruits, le miel ou certaines céréales, explique en partie la prévalence des caries dans ces populations.
L'étude conduite par ces chercheurs suédois montre l'existence d'autres infections, touchent souvent le parodonte, le tissu qui soutient les dents. Autrement dit, ils souffraient souvent de parodontites, qui se traduisent notamment par un déchaussement progressif des dents.
De telles affections sont notamment liées à un brossage irrégulier des dents. L'hygiène bucco-dentaire des Vikings devait donc laisser à désirer.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne prenaient pas du tout soin de leurs dents. En effet, certains indices suggèrent qu'ils utilisaient des cure-dents et qu'ils traitaient même les dents infectées. On note aussi des cas où les dents, notamment celles de devant, auraient été limées.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 05 Feb 2024 - 2min - 1429 - A quoi servait le géant en érection du village de Cerne Abbas ?
Près du village de Cerne Abbas, dans le Dorset, une province du sud-ouest de l'Angleterre, on peut observer, si on a pris assez de hauteur, ou si on se trouve de l'autre côté de la vallée, ce que les scientifiques nomment un géoglyphe.
Il s'agit un d'immense dessin, fait à même le sol, qu'ont peut notamment apercevoir en regardant par le hublot d'un avion. Les hommes auxquels on le doit l'ont composé en creusant de grandes tranchées, dans lesquelles ils ont versé de la craie broyée, ce qui empêche l'herbe de repousser. C'est ce procédé qui a permis à ce colossal dessin de traverser les siècles.
Le dessin représente un homme gigantesque, de 55 mètres de haut et 51 mètres de large. Il est représenté de face, un sexe, bien visible, en érection. Il brandit une massue. Le tracé d'une ligne, au niveau de la taille, laisse supposer qu'il pouvait porter une ceinture.
Ce géoglyphe, devenu un monument historique, attire depuis longtemps la curiosité des scientifiques. Selon eux, il date sans doute du Xe siècle, donc avant la conquête normande de 1066.
La massue et la position d'un de ses bras, qui laisse penser que le personnage était doté d'une cape, dont le contour a dû s'effacer, conduisent les spécialistes à attribuer l'identité d'Hercule au géant de Cerne Abbas.
La popularité, à l'époque considérée, de ce héros mythologique, et sa réputation d'invincibilité, expliquent qu'il ait été choisi comme thème de cet immense dessin. D'après les historiens, il aurait en effet servi de zone de rassemblement de l'armée saxonne et, de manière plus générale, de lieu de réunion en plein air.
Cette gigantesque figure aurait constitué un lieu de ralliement idéal pour regrouper des troupes destinées à lutter contre les raids des Vikings, qui partaient alors à l'assaut des côtes anglaises.
Le géant de Cerne Abbas n'est pas le seul géoglyphe de la région. Près de cette immense silhouette, se distingue également une grande poêle et un imposant cheval blanc, creusé dans une colline de craie.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 04 Feb 2024 - 2min - 1428 - Pourquoi Frank Abagnale est-il le roi des imposteurs ? (La folle épopée, épisode 3)
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui avait de l'imagination. Il aurait pu en tirer profit pour écrire des livres, mais ce n'est pas ce qui l'intéressait. Son truc à lui, c'était... l'imposture.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sat, 03 Feb 2024 - 6min - 1427 - Qu'est-ce qu'une terra nullius ?
On peut penser que, la plupart du temps, un territoire donné doit appartenir à un État. Ce qui n'a pas empêché les juristes médiévaux de créer la notion de "terra nullius". Ce qui signifie à peu près "terre de personne" ou "territoire sans maître".
Cette notion est sans rapport avec l'occupation du territoire en question. Ainsi, une "terra nullius" peut être habitée ou non.
Ce concept a été intégré à la "doctrine de la découverte", un ensemble de théories et de principes qui, à partir du XVe siècle, permettent de justifier la prise de possession d'un territoire et servent donc de prétexte à la colonisation.
Ainsi, pour les Européens de cette période, une terre habitée par un ou des peuples non chrétiens ou découverte par une nation non chrétienne peut être revendiquée, à la suite d'une occupation ou d'un débarquement sur ses rivages, par des explorateurs ou des militaires envoyés par un pays chrétien.
Les actions entreprises au nom de cette "doctrine de la découverte" sont largement considérées, aujourd'hui, comme dénuées de fondement et condamnables d'un point de vue moral.
Par ailleurs, la reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a notamment présidé au remodelage de l'Empire austro-hongrois, à la fin de la Première Guerre mondiale, a amené à considérer que toute terre habitée par une population permanente ne peut plus être considérée comme une "terra nullius".
Une telle dénomination, cependant, peut s'appliquer à un territoire inhabité ou peuplé d'une façon intermittente, et réclamé par aucun État.
Des "terrae nullius" encore aujourd'hui
Si l'on tient compte de cette nouvelle définition, on peut encore trouver des "terrae nullius" sur la carte du monde. C'est notamment le cas d'un territoire inhabité de l'Antarctique, la terre de Marie Byrd, qu'aucun pays ne revendique.
Quant au reste du continent antarctique, sur lequel plusieurs pays ont des prétentions, il a été déclaré continent neutre jusqu'en 2040.
Par ailleurs, un triangle désertique, entre l'Égypte et le Soudan, n'est réclamé, pour diverses raisons, par aucun des deux pays. On peut aussi le considérer comme une "terra nullius".
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 01 Feb 2024 - 1min - 1426 - Qu'est-il arrivé durant la Guerre des six jours ?
La création de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, n'est pas acceptée par ses voisins arabes, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. D'emblée, la cohabitation semble difficile, sinon impossible, entre ces pays et des habitants juifs souvent considérés comme des envahisseurs.
Aussi, dès le début, les conflits vont-ils émailler l'histoire des relations israélo-arabes. Aussitôt proclamée l'indépendance d'Israël, en mai 1948, une première guerre éclate, qui se termine, l'année suivante, par une série de cessez-le-feu.
Chacun des adversaires sait qu'ils ne règlent en rien la situation. Aussi Israël s'attend-il à un autre conflit, d'autant que l'Égypte, la Syrie et la Jordanie concluent, en 1966 et 1967, une alliance militaire.
La guerre prévisible éclate le 5 juin 1967. A priori, Israël se retrouve dans une situation délicate. Malgré la qualité reconnue d'une armée dotée des matériels les plus modernes, l'État hébreu doit en effet lutter sur plusieurs fronts, ce qui ne peut que le placer dans une position périlleuse.
Dans ces conditions, L'État-Major israélien va compter sur un élément décisif, l'effet de surprise. Devant la mobilisation des armées arabes et le blocus du détroit de Tiran, qui empêche les navires israéliens d'accéder à la mer Rouge, l'État hébreu décide de mener une attaque préventive.
Le 5 juin, des raids aériens détruisent les avions égyptiens au sol. La coalition n'a donc plus la maîtrise du ciel, d'autant que les avions jordaniens, moins nombreux, sont anéantis à leur tour, deux jours plus tard, par de nouveaux bombardements israéliens.
Disposant de la supériorité aérienne, Tsahal, nom donné à l'armée israélienne, n'a guère de mal à repousser les troupes jordaniennes et à atteindre le canal de Suez, ce qui oblige l'Égypte à capituler. Quant aux Syriens, ils doivent, devant l'avancée des troupes israéliennes, évacuer le plateau du Golan.
En tout, la guerre n'aura duré que six jours, du 5 au 10 juin 1967, d'où son nom. Elle aura permis aux Israéliens d'occuper la totalité de la ville de Jérusalem, mais aussi la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. L'ONU demande à Israël de se retirer de ce qu'il considère comme des "territoires occupés".
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 31 Jan 2024 - 2min - 1425 - Comment les passagers du vol 571 ont-ils survécu ? (La folle épopée, épisode 2)
Dans ce deuxième épisode de "La folle épopée", je vous raconte l'histoire des survivants du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Tue, 30 Jan 2024 - 6min - 1424 - Pourquoi Athéna n'est-elle pas seulement la déesse de la guerre ?
Les attributs guerriers de la déesse Athéna, le casque, la lance et le bouclier, semblent en faire une divinité belliqueuse. Et elle est bien considérée comme la déesse de la guerre et de la stratégie militaire.
Mais les fonctions de cette déesse, fille de Zeus et de la nymphe de la mer Métis, vont bien au-delà. En effet, il s'agit d'une divinité polyvalente.
Cette guerrière, armée de pied en cap, patronne aussi des activités qui ont besoin de la paix pour donne leur plein effet. De fait, Athéna est la protectrice des tisserands et des artisans en général.
Par ailleurs, l'un de ses emblèmes est la chouette, un oiseau qui, par sa faculté à voir dans l'obscurité, était considéré par les Grecs comme le symbole de la sagesse. C'est donc aussi l'un des attributs d'Athéna qui, de ce fait, patronne aussi les arts et les lettres.
Athéna est aussi une déesse "poliade", autrement dit la protectrice d'une cité. C'est en effet la divinité tutélaire d'Athènes, dont elle tire peut-être son nom, à moins que ce ne soit l'inverse.
Une autre caractéristique de cette déesse, c'est son côté altruiste, si l'on peut dire. En effet, elle aide volontiers les hommes. Pas tous cependant. En effet, elle a une prédilection pour les vaillants guerriers et les héros.
C'est ainsi qu'en tant que déesse de la guerre, elle aide les Achéens, comme nous l'apprend l'"Iliade", et soutient Ulysse de ses conseils. Elle se tient aussi aux côtés de héros comme Persée, dans son combat contre Méduse, ou Achille, qu'elle nourrit en versant dans son cœur le nectar et l'ambroisie.
Déesse de la sagesse et de la raison, Athéna est aussi une fauteuse de guerre. Ainsi, elle soutient les Grecs contre les Troyens, pour se venger de Pâris, le prince de Troie. En effet, celui-ci lui a préféré Aphrodite, qui lui a promis l'amour de la belle Hélène de Sparte.
C'est cette querelle de divinités qui, entre autres motifs, a déclenché une guerre de Troie qu'Athéna, humiliée, ne cessera d'attiser.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 29 Jan 2024 - 1min - 1423 - Pourquoi les nazis diffusaient de la musique dans les camps ?
On sait que des orchestres se sont constitués dans la plupart des camps de concentration nazis. Mais la musique n'exprimait pas, ou très peu, un désir d'évasion ou une volonté de résistance.
Les nazis avaient autre chose en tête. Ils repéraient les détenus musiciens et les obligeaient à s'intégrer à une formation musicale. Les instruments étaient parfois apportés au camp par les prisonniers eux-mêmes, envoyés par leurs proches ou achetés à l'extérieur, aux frais des détenus.
Pour les officiers allemands en charge des camps, la musique était une autre forme de torture. Ainsi, des chants de marche ou de combat, au tempo vif, accompagnaient les déplacements des prisonniers qui, déjà épuisés par les privations, devaient accorder leur pas au rythme de cette musique militaire.
La musique était omniprésente durant la journée, avec un répertoire immuable, composé de quelques mélodies ou chansons. Des airs étaient imposés aux détenus, qui devaient les chanter à certaines occasions. Ils s'exposaient à des sanctions s'ils n'obéissaient pas ou s'ils chantaient faux.
Aussi devaient-ils se livrer à des heures de répétition épuisantes, qui s'ajoutaient à leurs autres corvées.
Des détenus exténués devaient effectuer des tâches harassantes en chantant à tue-tête. Et les nazis poussaient la perversité jusqu'à obliger des détenus à entonner certains air avant d'être exécutés. C'est ainsi que les communistes devaient creuser leurs propres tombes en chantant "l'Internationale".
Dans les camps de concentration, la musique était également détournée de son sens. Ainsi, de la musique de chambre ou des mélodies sentimentales se faisaient entendre à l'arrivée des convois, quand les portes s'ouvraient sur des détenus harassés de faim et de fatigue, ou accompagnaient les prisonniers chargés d'enlever les cadavres des chambres à gaz.
Le soir, dans les baraquements, de la musique était encore diffusée par haut-parleur. C'était une nouvelle torture, car ces sonorités entêtantes empêchaient les détenus de trouver le sommeil.
Ces formations musicales servaient aussi à duper les visiteurs, impressionnés par la tenue et la qualité de ces orchestres, et à donner une fausse image de ces camps de la mort.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 28 Jan 2024 - 1min - 1422 - Quel est le massacre oublié de Tulle ?
La mémoire collective est restée marquée par l'horrible massacre d'Oradour-sur-Glane, perpétré, le 10 juin 1944, par la division SS "Das Reich", plus particulièrement chargée des opérations contre la résistance. Mais c'est la même unité qui, la veille, s'est rendue coupable d'une autre hécatombe.
Ce massacre, sans doute moins connu, a eu pour cadre la ville de Tulle. Les résistants locaux, très actifs dans la région, se sentent assez forts, au lendemain du débarquement allié en Normandie, qui a eu lieu la veille, pour s'emparer de la ville de Tulle.
C'est la première fois que des résistants s'en prennent ainsi à un centre urbain. Ils donnent donc l'assaut à la ville à l'aube du 7 juin. Les principaux lieux stratégiques sont rapidement investis par les résistants. Plusieurs soldats allemands, ainsi que des prisonniers, sont fusillés sans jugement.
Au soir du 8 juin, cependant, les premiers détachements de la division "Das Reich" entrent à Tulle. Ne s'estimant pas en état de leur résister, les maquisards abandonnent alors leurs positions, laissant la population exposée aux représailles des Allemands.
Après avoir failli fusiller le préfet, ces derniers apprennent que des soldats de la garnison de Tulle et des prisonniers ont été exécutés par les résistants. Selon la doctrine appliquée en la matière, ils décident de procéder à des représailles sur la population.
Aux yeux des Allemands, elles ont une vertu exemplaire et, par la terreur qu'elles inspirent, doivent dissuader les civils d'héberger ou d'aider les résistants.
Les SS font donc arrêter tous les hommes de 16 à 60 ans. Les autorités françaises, le préfet en tête, parviennent à faire libérer 3.500 prisonniers sur les 5.000 appréhendés. Les Allemands procèdent ensuite, sur la base de critères très vagues, à un second tri.
120 hommes sont finalement sélectionnés. Des cordes, terminées par des nœuds coulants, sont accrochées aux balcons, aux arbres et aux réverbères de la ville. 99 otages seront
finalement pendus. Mais l'horreur ne s'arrête pas là ; en effet, 149 habitants seront en plus déportés en Allemagne, dont 101 ne reviendront pas.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 25 Jan 2024 - 1min - 1421 - Pourquoi Henry Kissinger est-il controversé ?
Henry Kissinger, qui avait fêté son centième anniversaire le 27 mai dernier, vient de mourir. Conseiller à la sécurité nationale puis secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des affaires étrangères, sous les présidences de Richard Nixon et Gerald Ford, l'homme est aujourd'hui encore très controversé.
Certains observateurs soulignent le rôle positif que, selon eux, il a joué dans les affaires du monde. En effet, ses concitoyens, et une partie de la communauté internationale, lui ont été reconnaissants d'avoir mis fin, en 1973, à l'interminable guerre du Vietmam.
Une action qui lui avait d'ailleurs valu le prix Nobel de la paix. Sa diplomatie pragmatique, faite de petits pas et d'inlassables négociations, mit encore un terme à la guerre du Kippour, en 1973, qui opposait Israël à ses voisins arabes.
Ses partisans attribuent encore à Henry Kissinger la relance des négociations portant sur le désarmement nucléaire, entre les États-Unis et l'URSS, et l'amorce d'un dialogue constructif entre les Chinois et les Américains, couronné, en 1972, par le voyage historique du Président Nixon en Chine.
Mais cette "realpolitik", que d'aucuns qualifient de tortueuse, a également soulevé de vives critiques. Certains rappellent en effet que, à la fin de la guerre du Vietnam, Kissinger aurait été favorable au bombardement du Cambodge, pays neutre dans lequel le Viet-cong, la guérilla communiste opposée aux Américains, aurait créé des bases.
Selon certaines sources, ces bombardements auraient provoqué la mort de plusieurs dizaines de milliers de civils. Ses détracteurs reprochent aussi à Kissinger son implication dans le renversement, en partie fomenté par la CIA, du régime du Président Allende au Chili.
Des considérations géopolitiques, et la peur de l'avènement du communisme en Amérique latine, chasse gardée des États-Unis, expliqueraient aussi le soutien apporté à la dictature militaire du général Pinochet par un Kissinger indiquant à la presse qu'il n'y avait aucune raison d'assister sans rien faire à la mise en place d'un régime ayant, selon lui, des sympathies pour le communisme.
Ce soutien supposé au régime militaire chilien causera d'ailleurs quelques ennuis judiciaires à Henry Kissinger.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 24 Jan 2024 - 2min - 1420 - Qui est le Père Fouettard alsacien ?
Depuis longtemps, les enfants attendent avec impatience la venue du Père Noël ou, pour ceux vivant dans l'est de la France, celle de saint Nicolas. Ces deux personnages, en effet, viennent leur distribuer des cadeaux.
Du moins le font-ils si les enfants se montrés sages et obéissants durant l'année qui s'achève. Quant aux autres, ils pourraient recevoir des visites moins agréables. Celle du Père Fouettard, d'abord, qui donne le fouet aux petits Lorrains dissipés.
Et celle, ensuite, d'un certain Hans Trapp, souvent assimilé, d'ailleurs, au Père Fouettard. Ce personnage menaçant vient plutôt châtier les enfants alsaciens turbulents.
Si des personnages comme le Père Noël ou le Père Fouettard sont des figures légendaires, celui de Hans Trapp a un fondement historique.
Ce personnage, qui s'appelait en réalité Hans von Trotha, vivait, à la fin du XVe siècle, dans l'Électorat de Palatinat, qui faisait partie du Saint-Empire germanique.
En 1480, l'Électeur, qui gouverne le pays, donne à ce seigneur le château de Bertwarstein. Une décision qui provoque la colère de l'abbé de Wissembourg, le propriétaire du château.
L'abbé et ses moines protestent donc. En guise de réponse, Hans von Trotha provoque l'inondation des terres de l'abbaye en détournant le cours d'une rivière. Ce qui plonge la région dans le marasme.
L'abbé en appelle au Pape, qui convoque le fautif. Au lieu d'obtempérer, le seigneur critique le pontife, qui l'excommunie derechef. Ajoutée à son action contre l'abbé de Wissembourg, considérée comme un véritable méfait, cette excommunication est à l'origine de la mauvaise réputation de Hans von Trotha.
Surnommé Hans Trapp, une référence au bruit de ses pas, le personnage, qui aurait conclu un pacte avec le diable, aurait continué de parcourir l'Alsace. Durant les veillées, les paysans racontaient à voix basse que Hans Trapp détroussait les voyageurs et enlevait les enfants indociles pour les manger ou les abandonner dans la forêt.
Seul le bon saint Nicolas serait capable de venir à bout de ce personnage terrifiant qu'on peut encore voir défiler lors de la traditionnelle procession du marché de Noël de Wissembourg.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 22 Jan 2024 - 2min - 1419 - Pourquoi Louis XIV est-il surnommé le "Roi-Soleil" ?
La plupart de nos Rois de France ont hérité de surnoms. Mais il est rare qu'ils se les soient attribués eux-mêmes. C'est pourtant le cas de Louis XIV, qui a adopté, de façon délibérée, le surnom de "Roi-Soleil".
Il symbolisait en effet sa conception du pouvoir. En 1661, après la mort du cardinal Mazarin, son parrain et son mentor en politique, Louis XIV indique sa volonté de prendre le pouvoir personnellement et de se passer désormais de Premier ministre.
Cette date marque donc la véritable mise en place de la Monarchie absolue, dans laquelle tout vient du Roi et tout s'y rapporte. Comme le Soleil, autour duquel gravitent les autres planètes, est au centre du système solaire, le Roi est au centre du système gouvernemental et les ministres ne dépendent que de lui.
Ce surnom de Roi-Soleil trouve une autre de ses résonances dans l'organisation de la Cour. Traumatisé par l'expérience de la Fronde, durant laquelle la famille royale avait dû fuir Paris, le Roi s'était juré de mettre la noblesse au pas.
Il avait donc obligé ces fiers seigneurs, qui l'avaient jadis humilié, à paraître à Versailles et à participer à l'immuable cérémonial de la Cour. Si les nobles voulaient conserver places et pensions, il leur fallait assister au lever du Roi qui, comme le Soleil dispensait la lumière, accordait les grâces et les faveurs dont vivait la noblesse.
Tout ce minutieux système, réglé par une étiquette implacable, gravitait autour du Roi, comme les planètes autour du Soleil. Ce n'est donc pas pour rien qu'en 1662, au cours d'un célèbre ballet, Louis XIV, qui se piquait de danser, apparut vêtu en Soleil.
Même si le surnom de Roi-Soleil est le plus connu, le souverain en eut d'autres. En raison de sa naissance inespérée, sa mère, Anne d'Autriche n'étant tombée enceinte qu'après plus de 20 ans de mariage, on l'appela Louis "Dieudonné".
Quant à son autre surnom de "Louis le Grand", elle s'explique, là encore, par sa prétention à gouverner en Roi absolu.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 21 Jan 2024 - 1min - 1418 - Quel espion a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale ? (La folle épopée, épisode 1)
Dans ce premier épisode d'une série que j'ai nommée "La folle épopée" je vous raconte l'histoire fascinante de l'espion Richard Sorge.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Fri, 19 Jan 2024 - 7min - 1417 - Pourquoi le navire Endeavour est-il célèbre ?
En 2016, des plongeurs repèrent, dans la baie de Newport, l'épave du célèbre voilier "Endeavour". Il doit sa renommée à l'un de ses capitaines, l'explorateur James Cook.
Au départ, cependant, rien ne prédestinait ce trois-mâts, construit en 1764, à parcourir les mers du globe. En effet, ce bateau de 32 mètres de long, qui s'appela d'abord "Earl of Pembroke", avait pour seule mission de transporter du charbon le long des côtes du Yorkshire, en Angleterre.
Le navire est doté d'une robuste coque en bois et son faible tirant d'eau lui permet de s'approcher des côtes, ce qui favorise le débarquement aussi bien que le chargement et le déchargement des marchandises.
C'est sur les conseils de James Cook que le bateau est acheté en 1768 par l'Amirauté britannique. Né en 1728, Cook avait fait son apprentissage dans la marine marchande, avant de s'engager dans la Royal Navy, dont il franchit rapidement les échelons.
Durant la guerre de Sept Ans qui, de 1756 à 1763, oppose plusieurs pays européens, les aptitudes de James Cook pour la cartographie et la topographie sont remarquées.
C'est la raison pour laquelle il est choisi par l'Amirauté, en 1768, pour organiser une grande expédition scientifique. Elle a plusieurs objectifs. Le navire, rebaptisé "Endeavour", doit d'abord gagner Tahiti, pour y observer plus commodément le passage de la planète Vénus entre la Terre et le Soleil.
Ce qu'on appelle le transit de vénus devait permettre de mieux calculer la distance séparant la Terre du Soleil. La mission avait aussi pour objet, plus confidentiel, de repérer un éventuel continent austral, appelé "Terra australis".
Mais l'"Endeavour" prend aussi à son bord des scientifiques renommés. Un botaniste, un astronome et un naturaliste sont ainsi du voyage. Ils feront de nombreuses observations sur la faune et la flore de ces contrées lointaines.
Au terme de ce périple, en 1771, l'"Endeavour" ramènera ses passagers en Angleterre. Il redevient ensuite un navire de commerce, avant d'être envoyé par le fond, en 1778, pour servir à la mise en place d'un blocus maritime, durant la guerre d'indépendance américaine.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 18 Jan 2024 - 2min - 1416 - Comment la boite de conserve est-elle née ?
Les hommes ont toujours été confrontés à la difficulté de conserver les aliments. Sans conditionnement spécifique, en effet, leur goût s'altère et la prolifération de bactéries et de moisissures rend leur consommation dangereuse pour la santé.
Certains procédés de conservation avaient cependant été mis au point. Ainsi, on fumait ou salait certains aliments, tandis que d'autres étaient plongés dans le vinaigre ou d'autres substances.
Mais ces procédés étaient imparfaits et on était à la recherche, dans la marine notamment, de techniques de conservation plus efficaces.
C'est Nicolas Appert qui mettra au point la méthode la plus convaincante. Né en 1749, en Champagne, d'un père aubergiste, il s'initie aux métiers de bouche, et devient sommelier et cuisinier.
Puis il ouvre une confiserie qui attire bientôt une nombreuse clientèle. C'est dans l'exercice de sa profession qu'il découvrira, en 1795, le procédé qui le fera passer à la postérité.
Il s'aperçoit en effet qu'en plaçant des aliments dans un bocal en verre hermétique, et en le chauffant au bain-marie, il pouvait les conserver très longtemps. Conditionnés de la sorte, les aliments restaient savoureux et à l'abri des germes.
L'appertisation était née. Selon ce procédé, le fait de chauffer à 100°C des aliments contenus dans un récipient hermétique et étanche tue toutes les bactéries qui pourraient s'y développer.
Nicolas Appert n'a eu, à cet égard, qu'une heureuse intuition. Il faudra attendre les découvertes de Pasteur, en 1860, pour en avoir la confirmation scientifique.
S'il est un inventeur plein de ressources, Nicolas Appert ne veille guère à ses intérêts. En effet, comme il ne dépose pas le brevet de son invention, c'est un commerçant britannique, Peter Durand, qui le récupère.
C'est sous son nom qu'une firme anglaise fabrique, en 1814, les premières boîtes de conserve. Les aliments y sont placés dans des boîtes de fer blanc et chauffés à la bonne température.
Prenant peu de place, elles fournissent aux marins des vivres toujours disponibles, et en grande quantité. Dès lors, l'avenir des boîtes de conserve était assuré.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 17 Jan 2024 - 1min - 1415 - Quel est le mouvementclandestin du luddisme ?
Au début du XIXe siècle, les artisans du textile sont nombreux en Angleterre. Travaillant souvent à domicile, les tisserands sur coton ou les tondeurs de draps gagnent assez bien leur vie.
Mais cette relative prospérité est menacée par la généralisation du métier à tisser. Inventé à la fin du XVIIIe siècle, il est actionné par une machine à vapeur. Cette innovation technique permet aussi bien d'augmenter la productivité que d'améliorer la qualité des tissus.
Le métier à tisser faisant le travail de plusieurs artisans, ces derniers craignent de se retrouver sans emploi.
Face à cette menace, les artisans du textile ne tardent pas à exprimer leur colère. En mars 1811, ils manifestent à Nottingham et brisent des dizaines de métiers. On appellera bientôt "luddisme" cette forme de violence.
Le nom viendrait d'un certain Ned Ludd, un artisan qui aurait détruit deux métiers à tisser en 1779. Son existence n'est cependant pas vraiment avérée.
La manifestation de Nottingham est réprimée sans ménagement par l'armée. Ce qui n'empêche pas le mouvement de prendre rapidement de l'ampleur. Il tend en effet à s'organiser : de véritables expéditions sont menées contre des manufactures, dont seuls certains métiers sont brisés.
Les manifestants se scindent en petits groupes, chacun pourtant un masque, pour éviter d'être identifié. Parti de Nottingham, le luddisme s'étend à d'autres régions du Royaume.
En 1812, le mouvement tend à se durcir après la mort de deux manifestants. Grâce à des collectes de fonds, les luddistes se procurent des armes. Il s'agit désormais, non d'une simple protestation contre l'introduction des métiers à tisser, mais d'une véritable révolte contre le pouvoir politique.
Inquiet, le gouvernement mobilise une véritable armée pour venir à bout du mouvement. Il est d'ailleurs désorganisé par l'arrestation de plusieurs de ses membres. La peine capitale ayant été instaurée pour la destruction de machines, 13 luddistes sont même pendus.
Même si quelques bris de métiers sont encore signalés, le mouvement s'essouffle et disparaît avant 1820. Le luddisme, cependant, aura inspiré d'autres mouvements de contestation, comme le chartisme, qui apparaîtra quelques années plus tard.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 15 Jan 2024 - 2min - 1414 - Pourquoi Marie-Antoinette était-elle appelée la "veuve Capet" durant la Révolution française ?
Les acteurs de la Révolution française, et notamment les plus radicaux d'entre eux, les sans-culottes, étaient attachés à l'égalité sous toutes ses formes. C'est la raison pour laquelle ils adoptèrent le tutoiement et mirent en usage, dans leurs relations réciproques, le titre de "citoyen".
Cet égalitarisme s'appliquait aussi au Roi et à sa famille, dont ils se méfiaient. Aussi affectaient-ils une grande familiarité à l'égard de ces puissants qu'ils voulaient ramener à leur niveau.
Cela se traduisait notamment par l'attribution de sobriquets au Roi et à la Reine. Ainsi appelait-on souvent bMarie-Antoinette "l'Autrichienne", en raison de ses origines, ou "Madame Veto", en référence à l'attitude de son mari, qui avait opposé le veto que lui reconnaissait la Constitution à diverses mesures prises par les révolutionnaires.
On se souvient aussi que, à l'occasion du retour de la famille royale à Paris, lors des journées d'octobre 1789, la foule affamée avait donné au Roi, à la Reine et au dauphin les surnoms de "boulanger, boulangère et petit mitron".
Mais la Reine eut encore droit à un autre surnom, celui de la "veuve Capet". On commença à l'appeler ainsi au lendemain de l'exécution de Louis XVI, survenue le 21 janvier 1793.
Si on lui donna ce nom, c'est que le monarque lui-même, déchu depuis septembre 1792, était nommé "Louis Capet". En effet, il n'était plus question de donner son titre royal à un souverain qui devait être traité comme tous les autres citoyens.
On chercha donc un nouveau nom pour lui et on lui attribua celui qu'avait porté Hugues Capet, l'ancêtre déclaré des Capétiens, qui avait donné son nom à la dynastie. Il fut d'abord duc des Francs, puis, entre 987 et 996, Roi de ce qu'on appelait encore la Francie.
Ce surnom de "Capet" vient peut-être de la qualité d'abbé laïc d'Hugues, qui l'amenait à porter une courte cape, insigne de sa fonction. On ne le lui donna d'ailleurs pas de son vivant, mais seulement à partir du début du XIIe siècle.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 14 Jan 2024 - 1min - 1413 - A quoi sert la « pierre du destin » ?
Le couronnement des Rois d'Angleterre s'organise autour de rituels séculaires. Les objets jouent un rôle notable dans ces vénérables cérémonies. C'est ainsi que, lors de son couronnement, en mai dernier, Charles III a coiffé la couronne de saint Édouard et a tenu en main le sceptre et le globe, symboles de son pouvoir.
Mais il s'est également assis sur la chaise du Roi Édouard, le trône où le souverain prend place pour être oint par l'archevêque de Cantorbéry.
Et, sous cette chaise vieille de sept siècles, a été glissé un autre objet rituel : la "pierre du destin", appelée aussi pierre de Scone.
Il s'agit d'un bloc de grès rectangulaire pesant environ 150 kilos. Il est percé de quelques trous et des anneaux de fer sont fixés à chacune de ses extrémités. On peut encore distinguer, sur sa surface, quelques croix à moitié effacées.
L'origine de cette pierre du destin est mal connue. Elle a en effet donné lieu à nombre de légendes. D'après l'un de ces récits fabuleux, ce bloc de pierre aurait servi d'oreiller à Jacob, le petit-fils d'Abraham.
Selon une autre légende, la pierre serait venue de Terre Sainte et aurait voyagé jusqu'en Écosse, où elle aurait été déposée, au IXe siècle, au monastère de Scone.
Certains historiens pensent que l'origine de la pierre est plutôt à rechercher du côté des Pictes, un peuple ayant occupé le nord de l'actuelle Écosse jusqu'au Xe siècle.
Quoi qu'il en soit de ses origines, la pierre du destin était utilisée lors du couronnement des Rois d'Écosse. À partir du milieu du IXe siècle, ils prennent place sur cette pierre pour être sacrés. Elle devient un élément essentiel de leur légitimité.
En 1292, à la suite d'une rébellion des Écossais contre leur suzerain, le Roi d'Angleterre Édouard Ier, les Anglais s'emparent de la pierre du destin, conservée à l'abbaye de Scone.
Elle sera désormais placée sous le trône du couronnement, la chaise du Roi Édouard, de manière à symboliser la sujétion des Écossais.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 11 Jan 2024 - 1min - 1412 - Pourquoi parle-t-on de la « rafle de Marseille » ?
En novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone libre. Les troupes allemandes subissent alors des attentats.
C'est ainsi qu'à Marseille, occupée depuis la mi-novembre 1942, des officiers et des soldats allemands périssent dans un attentat du 3 janvier 1943. Conformément à une directive secrète d'Heinrich Himmler, en charge de la sécurité du Reich, des représailles sont décidées.
Elles sont de deux ordres. En premier lieu, et comme toujours en cas d'attentat, des milliers de personnes doivent être déportées vers l'Allemagne. Par ailleurs, le quartier du Vieux-Port de Marseille, où a eu lieu l'attaque, doit être détruit. Son réseau de petites ruelles semblait en effet aux Allemands trop favorable à la préparation d'un attentat et à la dissimulation des "terroristes".
Selon les accords passés entre les responsables nazis chargés de la sécurité et René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, la police française devait participer à ces opérations de représailles.
Bousquet y voyait un moyen de préserver l'autonomie de ses services. Les 22, 23 et 24 janvier 1943, les troupes allemandes, appuyées par des compagnies de gardes mobiles et des escadrons de gendarmerie français, procèdent à l'arrestation de près de 6.000 personnes, dont 1.642 seront déportées vers Drancy et des camps de concentration allemands. Parmi elles, plus de 780 juifs sont victimes de cette rafle.
Par ailleurs, le quartier du Vieux-Port est bouclé et une partie de la ville fait l'objet de perquisitions systématiques. En effet, les maisons sont fouillées une à une. Et à partir du 1er février 1943, des charges explosives font sauter plus de 1.200 immeubles, entraînant la destruction de toute la partie nord du Vieux-Port. Le quartier n'est plus qu'un amas de ruines.
Au préalable, les habitants du quartier, dont beaucoup d'immigrants italiens, ont été expulsés sans ménagement de leurs logements. Au total, plus de 20.000 Marseillais seront évacués de chez eux.
La reconstruction de ce quartier prendra beaucoup de temps et ne sera achevée qu'en 1956.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 10 Jan 2024 - 2min - 1411 - Qu'est-ce que le projet West Ford ?
Chaque État a à cœur d'assurer la protection de ses liaisons à longue distance. Ce souci est encore plus évident durant des périodes comme la guerre froide, pendant lesquelles les pays rivaux s'efforcent de brouiller les communications téléphoniques de leurs adversaires.
C'est pourquoi les Américains ont conçu, à cette époque, un ambitieux projet destiné à préserver ces communications et à en améliorer la qualité.
Ce projet "West Ford" , élaboré au début des années 1960, répondait plus précisément à une demande des militaires qui, dans la perspective d'un éventuel conflit avec l'URSS, voulaient disposer d'un système de liaison à grande distance propre à remplacer les câbles sous-marins.
Pour la mise au point de ce dispositif de protection, les militaires font appel aux services de prestigieux "Massachusetts Institute of Technology" (MIT). Ses ingénieurs imaginent de mettre en orbite, autour de la Terre, des centaines de millions d'aiguilles de cuivre aussi fines que des cheveux. Chacune d'entre elles, en effet, ne pesait pas plus de 40 microgrammes.
Une fois regroupées, ces aiguilles devaient former un ensemble de 15 kilomètres de large et de 30 kilomètres d'épaisseur.
Unies les unes aux autres, elles devaient donc former comme un gigantesque anneau de cuivre, ceinturant la planète. Son rôle était de réfléchir, vers l'espace, les rayons solaires pouvant perturber les transmissions radio.
Une première tentative de lancement de ces aiguilles, en 1961, ne s'était pas très bien passée. Un second essai, en 1963, avait mieux réussi. Cependant, la mise en place de ce bouclier artificiel avait été critiquée, tant par une partie de la communauté scientifique, qui craignait que ces aiguilles ne perturbent les observations astronomiques, que par certains pays.
Surtout, ce projet est rapidement rendu obsolète par les progrès des satellites de télécommunications. La plupart de ces aiguilles ont fini par rentrer dans l'atmosphère. Mais certaines d'entre elles, regroupées à plus de 3.500 kilomètres d'altitude, sont toujours en orbite.
Elles font partie, aujourd'hui, de ces milliers de débris spatiaux qui encombrent l'espace.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 08 Jan 2024 - 2min - 1410 - Napoléon était-il petit ?
Dans notre mémoire collective, le personnage de Napoléon est souvent vu d'une certaine manière. Ainsi, on s'imagine volontiers l'Empereur coiffé de son célèbre bicorne et la main droite dans son gilet. On se le représente aussi comme un homme de petite taille.
le "petit tondu", comme l'appelaient familièrement ses soldats, était-il donc un nabot ? En fait, il n'en est rien. En effet, Napoléon a été mesuré à plusieurs reprises au cours de sa vie.
Il l'a été par son premier valet de chambre, Louis-Joseph-Narcisse Marchand. On a aussi évalué sa taille avant son voyage vers Sainte-Hélène, en 1815, et à son arrivée dans l'île.
Or, ces mesures varient entre 1 mètre 68 et 1 mètre 70. Étant donné que, en 1792, la taille minimale pour être incorporé dans l'armée était d'environ 1 mètre 62, Napoléon était sans doute un peu plus grand que la moyenne des hommes de son époque.
D'où vient alors cette légende de la petite taille de l'Empereur ? Elle est d'abord née de la manière dont on le représente souvent à l'époque. Sur les tableaux et les gravures, en effet, on le voit souvent entouré des grenadiers de sa garde, dont font partie les fameux "grognards".
Or ces hommes sont de véritables géants pour leur époque. Ils ne sont en effet acceptés dans cette prestigieuse formation militaire que s'ils mesurent plus d'1 mètre 80.
Au surplus, ils sont coiffés de ces hauts bonnets à poils qui ornent encore le chef de certains militaires anglais. Leur taille était encore grandie par ce couvre-chef. À leurs côtés, Napoléon paraissait en effet bien petit.
Mais cette assertion fait aussi partie de la légende noire de l'Empereur, colportée par les Anglais, ses ennemis les plus acharnés. Le pied anglais, différent du pied français, n'accordait à Napoléon qu'une taille inférieure à 1 mètre 60.
Il n'en fallait pas plus pour que les caricaturistes anglais représentent Napoléon comme une sorte d'avorton, paraissant minuscule auprès de John Bull, ce Britannique massif censé symboliser la nation anglaise.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 07 Jan 2024 - 1min - 1409 - 3 recommandations pour ce week-end
1/ Pourquoi le "y" est-il grec ?
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/pourquoi-le-y-est-il-grec/id1048372492?i=1000640425090
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/7177g2059O7XKzFMdhPUKy?si=8d9ce9e0d3ed412c
2/ Qu'est-ce qu'une « impasse mexicaine » au cinéma ?
Apple Podcasts:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/5ZkjGDh6dODYbvgOv16fSe?si=5ea0d2ff45954535
3/ Pourquoi Richelieu serait-il à l'origine des couteaux ronds ?
Apple Podcasts:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/4XeBb49bZH8Eq4K7Eqxvsz?si=0cfca48730ca4eb7
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sat, 06 Jan 2024 - 0min - 1408 - Quelle princesse a épousé deux Rois de France ?
Certaines Reines de France eurent un destin singulier. C'est notamment le cas d'Anne de Bretagne, qui fut Reine à plus d'un titre. En effet, cas unique dans les annales de notre Histoire, elle épousa deux Rois de France.
Avant de monter sur le trône, cette princesse fut d'abord la dernière souveraine d'un duché de Bretagne indépendant, même s'il est rattaché à la Couronne de France par les coutumes féodales.
Née en 1477, Anne de Bretagne est la fille et l'héritière du duc François II. Elle succède à son père en 1488, l'année où le Roi Charles Charles VIII remporte une victoire décisive sur le duc de Bretagne et ses alliés, qui s'étaient insurgés contre le pouvoir royal.
Pour préserver l'indépendance du duché, les conseillers de la jeune princesse arrangent son mariage avec Maximilien d'Autriche, fils de l'Empereur Frédéric III et futur Empereur germanique lui-même.
Ce mariage par procuration fait l'effet d'une provocation à la Cour de France. Il entraîne la mise sur pied d'une expédition militaire, qui aboutit au siège de Rennes, où se trouve la duchesse.
Même si le mariage d'Anne de Bretagne avec Maximilien ne sera annulé par Rome que deux mois plus tard, en février 1492, la princesse épouse Charles VIII en décembre 1491. Ce mariage n'entraîne pas l'annexion de la Bretagne à la France.
En effet, il scelle un régime d'union personnelle des deux Couronnes, qui durera jusqu'à la mort d'Anne de Bretagne. Celle-ci devient donc, une première fois, Reine de France.
Tous les enfants du couple étant morts en bas âge, c'est Louis d'Orléans, petit-fils d'un frère de Charles VI, qui devient Roi sous le nom de Louis XII. En 1499, il épouse Anne de Bretagne, après l'annulation de son mariage avec Jeanne de France, fille de Louis XI.
Jusqu'à sa mort, en 1532, Anne de Bretagne, deux fois Reine de France, maintient l'autonomie de son duché et se comporte comme sa souveraine. Il ne sera donc vraiment intégré au Royaume de France qu'à cette date, par la signature de l'édit d'Union.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 04 Jan 2024 - 1min - 1407 - Quel Roi de France est mort au cours d'un tournoi ?
Certains Rois de France ont connu une mort tragique et particulièrement brutale. C'est le cas d'Henri II. Quand, le 30 juin 1559, à l'occasion de deux mariages princiers, un tournoi est organisé, le Roi est loin de se douter qu'il vit ses dernières heures.
Même si ces joutes sont un peu passées de mode, elles sont encore très appréciées de la noblesse. Henri II s'est déjà lancé deux fois dans la lice, faisant bonne figure face au duc de guise et faisant vaciller le duc de Savoie sur sa selle.
Mais il veut encore disputer une troisième lance, cette fois-ci contre le capitaine de sa garde écossaise, le comte de Montgomery. La journée s'achève et le souverain a l'air fatigué.
Saisie d'un pressentiment, la Reine Catherine de Médicis, férue d'astronomie, tente de la dissuader. Mais Henri II veut briller aux yeux de sa maîtresse, la toujours belle Diane de Poitiers.
Les deux adversaires viennent de s'affronter, au cours d'un premier assaut. Ils s'apprêtent à s'élancer à nouveau l'un vers l'autre. Montgomery ne songe pas à remplacer sa lance, qui s'est brisée au début de l'affrontement.
Les deux cavaliers ferment leur heaume et pointent leurs lances. Un coup d'éperon et les chevaux partent au galop. Les voilà côte-à-côté, et soudain, Montgomery tend sa lance vers le Roi.
Les spectateurs, horrifiés, la voient soulever la visière du heaume et rester fichée dans le visage du souverain. Le Roi s'affaisse sur son cheval, qui marque le pas et finit par s'arrêter.
La blessure est hideuse : les échardes épointées de la lance ont pénétré dans l'œil droit du monarque. La médecine du temps ne peut pas faire grand chose pour soulager le Roi, qui souffre atrocement.
On lave la blessure et on s'efforce d'enlever quelques éclats. Le célèbre Ambroise Paré, appelé au chevet d'Henri II, n'ose pas retirer la lance, comme il avait enlevé de son visage celle qui devait valoir au duc de Guise son surnom de Balafré. Le Roi continue donc d'agoniser et expire le 10 juillet, en proie à de vives douleurs.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 03 Jan 2024 - 1min - 1406 - Comment l’Abbé Pierre a-t-il sauvé le frère de De Gaulle ?
Henri Grouès, mondialement connu sous le pseudonyme de l'"abbé Pierre", a eu plusieurs vies. L'une d'elle l'a amené à entrer dans la résistance, qui lui a d'ailleurs procuré le nom de guerre qui lui est resté.
Durant cette période tragique, l'action de l'abbé Pierre est multiple. En effet, il héberge des enfants juifs dont les parents ont été arrêtés par les Allemands, au cours des rafles organisées en zone Sud.
Plus tard, il aidera les réfractaires au Service du travail obligatoire (STO) à échapper à la police. Il participe même à la formation et à la direction de maquis, dont le célèbre maquis du Vercors.
Mais l'action de résistant de l'abbé Pierre revêt encore un autre aspect. Il participe en effet à l'un des nombreux réseaux permettant à des juifs, des maquisards ou des personnes recherchées par les Allemands ou la police de Vichy, de quitter la France pour se réfugier dans un pays plus sûr.
C'était notamment le cas du réseau mis sur pied par l'abbé Marius Jolivet, qui a permis à de très nombreuses personnes en fuite de passer en Suisse.
L'abbé Pierre a collaboré avec ce réseau. Et, parmi les personnes qu'il a ainsi aidées, figure le frère d'un Français déjà illustre, le général de Gaulle. Il s'agit de Jacques de Gaulle, l'un des trois frères du chef de la France libre.
Ingénieur des mines, il a été frappé, en 1926, par une maladie qui l'a laissé tétraplégique. En 1944, menacé d'être arrêté, à cause du nom qu'il porte, Jacques de Gaulle parvient à fuir Grenoble, où il habite.
Il est alors pris en charge par le réseau de l'abbé Jolivet. Avec d'autres résistants, l'abbé Pierre l'accompagne jusqu'à la frontière suisse. Mais comment le frère du général, qui ne peut marcher, pourrait-il franchir les barbelés su poste frontière ?
L'abbé Pierre décide alors de porter cet homme, aussi grand que son frère, et de lui faire passer la frontière, avec la complicité des douaniers suisses, qui écartent les barbelés pour laisser passage au paralytique.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 01 Jan 2024 - 1min - 1405 - Bonnes fêtes de fin d'année !
Rendez-vous le 1er janvier pour la reprise !
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 25 Dec 2023 - 1min - 1404 - Comment l'holodomor a terrassé l'Ukraine ?
L'"Holodomor", qui frappa l'Ukraine en 1932-1933, fut une effroyable tragédie. Le mot, qui peut se traduire par "faim", ou même, par extension, "extermination par la faim", désigne la terrible famine qui frappa alors cette République de l'URSS.
Selon les chiffres donnés par les historiens, on peut estimer le nombre de victimes entre 2,5 et 5 millions. Par ailleurs, et même si cet aspect intentionnel est contesté par certains, il ne fait guère de doute que cette famine ait été sciemment voulue et organisée par Staline lui-même.
C'est pourquoi l'Holodomor est souvent décrit comme un véritable génocide.
Cette terrible famine a plusieurs causes. La première résulte de la volonté de Staline d'industrialiser le pays à marches forcées. Pour cela, il avait besoin d'équipements qu'il ne pouvait qu'importer de l'étranger.
Pour en avoir les moyens, il décida d'exporter massivement les céréales cultivées en Ukraine, qui était alors un véritable grenier à blé pour l'URSS. Le tiers de ces céréales est vendu dès 1930, plus de 40 % l'année suivante. C'est autant de blé enlevé à la consommation des paysans ukrainiens.
D'ailleurs Staline s'en méfie. Depuis l'instauration de la NEP par Lénine, au début des années 1920, qui avait réintroduit en partie la propriété privée, ces paysans assez prospères passaient pour des capitalistes aux yeux du dictateur soviétique.
Et il les soupçonne d'autant plus que le peuple ukrainien, dans son ensemble, a réussi à préserver ses coutumes. Alors, pour faire cesser ce particularisme et ces velléités d'autonomie des paysans ukrainiens, Staline décide, au début des années 1930, de collectiviser l'agriculture.
Mais la majorité des fermiers se rebellent contre cette suppression de la propriété privée. Une terrible répression s'abat alors sur eux. Elle se manifeste notamment par la confiscation de toutes leurs réserves de grains.
Par ailleurs, les routes sont bloquées, empêchant les paysans de trouver du secours ailleurs. Le piège de la faim se referme alors sur eux. Privés de nourriture, des milliers de gens affamés meurent chez eux ou dans les rues. On signale même plusieurs cas de cannibalisme.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 21 Dec 2023 - 2min - 1403 - Qu'est-ce que la doctrine Truman ?
Le 5 mars 1946, dans son célèbre discours de Fulton, l'ancien Premier ministre Winston Churchill constate qu'un "rideau de fer" coupe désormais l'Europe en deux parties.
Il sépare désormais les pays de l'Europe occidentale, restés fidèles aux valeurs démocratiques, de l'URSS et de ses satellites d'Europe de l'Est, voués à une version totalitaire du communisme.
Or le camp communiste, sous l'égide de Moscou, ne cache pas ses visées expansionnistes. Au début de l'année 1947, la Grèce, en proie à une guerre civile opposant les troupes royalistes aux formations communistes, risque en effet d'être intégrée au bloc soviétique.
Et ce d'autant plus que le Royaume-Uni, son allié traditionnel, est ruiné par la guerre et n'a plus les moyens de la soutenir.
C'est dans ce contexte que le Président Truman, qui a succédé à Roosevelt au début de l'année 1945, décide d'intervenir. Dans le discours, non moins fameux que celui de Fulton, qu'il prononce le 12 mars 1947, il définit ce qu'on devait appeler la "doctrine Truman".
Elle consiste à soutenir, par tous les moyens, les régimes démocratiques menacés par le communisme, défini comme un système reposant sur la terreur et le bâillonnement de toute opposition.
Une telle politique fait des États-Unis une sorte de gendarme du monde, intervenant partout où le "monde libre" semble menacé. Sa mise en place ne semblait pas évidente à un moment où, au sortir d'une guerre qui avait vu l'intervention décisive du pays, la majorité des Américains restaient fidèles à l'isolationnisme.
Cette politique d'"endiguement", comme on l'a aussi appelée, se manifeste par un soutien à la Grèce. Mais elle se traduit aussi par la mise en place, en 1948, du plan Marshall, destiné à toute l'Europe, mais conçu en fait pour les seuls pays d'Europe occidentale.
Il s'agit d'une aide économique massive, qui devait éviter que des pays ravagés par la guerre ne se laissent séduire par un communisme prompt à vanter ses réussites en termes de lutte contre la misère.
La doctrine Truman marque donc bien l'entrée du monde dans la guerre froide.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 20 Dec 2023 - 2min - 1402 - Pourquoi Valentin Haüy a-t-il joué un rôle majeur pour les aveugles ?
Né en 1745, dans une famille de tisserands, Valentin Haüy montre une aptitude particulière pour les langues. Il en apprend plusieurs et met au point la version française de documents écrits en langues étrangères.
En 1771, alors qu'il est encore adolescent, il est ému des railleries qui accueillent un spectacle donné à Paris par de jeunes aveugles. Dès lors, sa vocation est née. Il leur consacrera sa vie.
En 1786, il fonde, comme il le souhaitait, une école pour les aveugles, l'Institution des Enfants Aveugles.
L'un des buts de cette école était d'apprendre à lire aux jeunes aveugles. Depuis qu'il avait fait une aumône à un mendiant aveugle, en 1784, Valentin Haüy pensait la chose tout à fait possible.
En effet, le mendiant avait reconnu la valeur de la pièce mise dans sa main. Pour cela, il avait usé d'un autre sens que la vue, le toucher.
Aussi Valentin Haüy met-il au point un système de lettres en relief. Il s'agit des lettres romaines ordinaires, mais très agrandies. En touchant ces lettres, les aveugles peuvent former des mots, puis des phrases. Ils apprennent donc à lire avec ce dispositif.
Mais le calcul et l'arithmétique ne sont pas oubliés. Conçus de la même manière que les lettres, des chiffres sont également mis à la disposition des élèves.
L'Institution a un second objectif : apprendre un métier à ces jeunes aveugles. Afin d'éviter que, privés de moyens d'existence, ils aient recours à la mendicité. Certains s'initient ainsi à la profession de typographe, d'autres aux secrets de la filature.
Durant la Révolution française, l'école passe sous le contrôle de l'État et devient l'Institut national des jeunes aveugles. Cet organisme à visée professionnelle continue à former les jeunes aveugles et à leur donner un métier.
Devenu infirme, Valentin Haüy meurt en 1822, soit sept ans avant l'invention décisive, par Louis Braille, du système d'écriture qui, conçu spécialement pour les aveugles, allait porter son nom.
Valentin Haüy a cependant été le premier à s'intéresser vraiment au sort dfes aveugles, délaissés par la société du temps.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 18 Dec 2023 - 1min - 1401 - Comment le dignitaire nazi Rudolf Hess a-t-il été capturé par les Anglais ?
Au printemps 1941, Rudolf Hess, un des principaux dignitaires nazis, qu'Hitler avait même désigné comme son dauphin, s'envole pour l'Angleterre. Il est seul aux commandes de son avion.
On a beaucoup discuté pour savoir si cette curieuse initiative avait été prise avec l'accord du Führer. Certains soulignent qu'il se serait mis dans une violente colère à l'annonce de l'escapade de son subordonné.
Pour d'autres, ce n'est qu'une comédie, Hitler ayant, en secret, approuvé la folle échappée de son second. Mais quel but pouvait-elle bien avoir?
Rudolf Hess serait allé négocier une paix séparée avec l'Angleterre. Alors qu'Hitler s'apprête à envahir la Russie, elle lui aurait évité d'avoir à combattre sur deux fronts. Les Anglais laisseraient les mains libres aux nazis, en Europe, et pourraient conserver, en échange, toutes leurs possessions coloniales.
Une très longue détention
Le 10 mai 1941, l'avion de Rudolf Hess, après avoir été pris en chasse par la Royal Air Force, s'écrase au-dessus de l'Écosse. Mais son pilote a eu le temps de s'éjecter et de sauter en parachute.
Une fois au sol, Hess, qui est fait prisonnier, demande à voir le duc de Hamilton, aristocrate influent et propriétaire du domaine sur lequel il se trouve. Il ne s'est pas rendu en Écosse par hasard, car il attribue au duc des sentiments germanophiles.
Aussi demande-t-il à parler, par son intermédiaire, au Roi ou au Premier ministre. Aucun des deux ne fera le déplacement. En tant qu'ennemi, Rudolf Hess sera incarcéré. Et il le sera jusqu'à sa mort.
Le dignitaire nazi, qui ne sortira de sa prison que pour être jugé à Nuremberg, en 1945, restera enfermé jusqu'en 1987, date de sa mort. Après 46 ans de détention, il finira par se suicider, à l'âge de 93 ans, dans la prison de Spandau, où il était le seul prisonnier.
L'équipée de Rudolf Hess a paru tellement folle que beaucoup ont pensé que l'homme enfermé à Spandau n'était en fait qu'un sosie du dignitaire nazi. On se demande, dans ce cas, comment il aurait pu abuser ses co-accusés à Nuremberg. De toute façon, des analyses ADN semblent prouver que le détenu était bien Rudolf Hess.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 17 Dec 2023 - 1min - 1400 - Êtes-vous certain de maîtriser la langue française ?
Pour écouter le nouveau podcast "Franc-parler":
Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/franc-parler/id1719737952
Spotify: https://open.spotify.com/show/4ebaP6J0tjC8QTJaYHiUbu
Deezer: https://deezer.com/show/1000488492
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sat, 16 Dec 2023 - 1min - 1399 - Depuis quand mange-t-on des tomates en France ?
La tomate a tous les caractères du fruit, mais, comme on peut la consommer salée, elle peut être aussi considérée comme un légume. Fruit ou légume, elle s'invite en tous cas sur toutes les tables de l'été.
Mais, au fait, depuis quand en mange-t-on chez nous ? La tomate nous vient d'Amérique du Sud. Le mot lui-même est emprunté au vocabulaire aztèque. Il est tiré du mot "tomatl", qui désignait le fruit de la tomatille, un fruit-légume consommé au Mexique.
C'est dans ce pays que la tomate est d'abord cultivée. C'est là que la trouvent les conquistadors qui, sous la conduite d'Hernan Cortés, conquièrent Mexico en 1519.
C'est donc par les Espagnols que la tomate est introduite en Europe dès le XVIe siècle. Mais les Français ne la mettront pas tout de suite dans leurs assiettes. En effet, elle ne fut pas considérée tout de suite comme un fruit, ou un légume, comestible.
Les scientifiques de l'époque l'associent en effet à la belladone, une plante dont les baies sont très toxiques. Et, de fait, les deux végétaux appartiennent à la même famille. On en conclut donc que la tomate est vénéneuse.
Comme on trouve la plante assez décorative, on s'en sert pour orner son jardin. En France, la première mention de la tomate, comme plante d'ornement, se trouve dans un des ouvrages de l'agronome Olivier de Serres, paru en 1600.
C'est en Provence que la tomate a d'abord été connue. Et c'est aussi là qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle on commence à en apprécier les vertus gustatives. Peu à peu, on découvre que ce fruit est non seulement comestible, mais qu'il constitue un mets excellent.
Diderot et d'Alembert en parlent dans leur fameuse "Encyclopédie", parue à la fin du XVIIIe siècle. Ils notent sa saveur "succulente" et son goût "agréable". Mais l'usage de la tomate, comme aliment apprécié des Français, ne se répand vraiment qu'à partir de la montée à Paris des Provençaux, en juillet 1790, à l'occasion de la fête de la Fédération.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 14 Dec 2023 - 1min - 1398 - Quel signe distinctif les juifs devaient-ils porter au Moyen-Âge ?
Pour écouter l'épisode du Coin philo, La fin justifie-t-elle les moyens ? (1/2):
Apple Podcast:
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/2j7cf5ZRs0fR4zd5HcKbB3?si=ae5c7c612857417f
Deezer:
https://deezer.page.link/E3KzM1QoW3K6YMbt6
-----------------
La discrimination qu'ont dû subir les juifs dans l'Allemagne nazie, et qui a conduit à la Shoah, n'a pas commencé à cette époque, même si, à cette occasion, elle s'est manifestée avec une rigueur et une férocité jamais atteintes auparavant.
Dès le VIIIe siècle, en effet, les juifs vivant dans les pays contrôlés par l'Islam devaient afficher un insigne distinctif, porté d'ailleurs aussi, même s'il était d'une autre couleur, par les chrétiens.
Durant le Moyen-Âge, les juifs de plusieurs pays européens furent aussi l'objet d'une telle discrimination.
C'est l'Église catholique qui décide du principe de ce signe distinctif. En effet, à l'occasion de la tenue du concile du Latran, en 1215, le Pape Innocent III ordonne aux juifs des Royaumes chrétiens d'Occident de porter un insigne spécial.
Il s'agissait, en effet, de distinguer des chrétiens des juifs qui étaient encore considérés par l'Église comme collectivement responsables de la mort du Christ.
La mesure est rapidement adoptée en Angleterre. Tout juif de plus de 7 ans devait arborer sur le côté gauche de ses vêtements une pièce de tissu jaune, dont les dimensions étaient précisées.
En France, saint Louis impose, en 1269, le port d'une "rouelle" aux hommes juifs. Comme son nom le laisse supposer, cette pièce de tissu, de couleur jaune, a la forme d'une petite roue.
Découpé d'une certaine façon, cet insigne évoquerait les 30 deniers qui furent le salaire de Judas pour livrer Jésus. Elle pourrait aussi figurer une hostie, symbole, pour les juifs, d'une pratique religieuse qui n'est pas la leur.
La forme et la taille de la rouelle, ainsi que l'âge à partir duquel elle doit être portée, font l'objet de nombreuses modifications. Elle est d'ailleurs adoptée, à la même époque, dans d'autres pays, comme l'Espagne.
Dans d'autres, comme certains États allemands, c'est un chapeau, généralement de forme conique, qui servira à distinguer les juifs des chrétiens. Un tel couvre-chef devait d'ailleurs être adopté par les juives en France.
Rappelons enfin qu'en plus de porter cet insigne, les juifs du Moyen-Âge devaient souvent vivre dans des quartiers séparés, les ghettos.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 13 Dec 2023 - 2min - 1397 - De quel événement Agatha Christie s'est inspirée pour Le crime de l'Orient Express ?
En 1934, paraît l'un des plus fameux romans d'Agatha Christie, "Le crime de l'Orient-Express". Un meurtre est en effet découvert dans l'un des wagons de ce train prestigieux. L'un des passagers, le célèbre Hercule Poirot, ne tardera pas à résoudre l'énigme : tous les voyageurs ont donné un coup de couteau à l'infortunée victime.
Or la romancière s'était inspirée d'un fait divers réel pour écrire son récit. Le cadre en était bien l'Orient-Express, qui, parti de Paris le 31 janvier 1929, devait amener ses passagers à Istanbul.
Or, à environ 130 kilomètres de son terminus, le train qui, après avoir franchi la frontière bulgare, s'est engagé sur le territoire turc, est ralenti par une violente tempête de neige. Bientôt des congères se forment, à l'avant comme l'arrière du convoi, et le train finit par être bloqué.
Des passagers manquant de tout
La situation devient rapidement difficile pour les passagers, pris dans un piège glacé. En effet, la température est sibérienne, le thermomètre descendant jusqu'à moins 25°C. Bientôt privé de charbon, le personnel ne peut plus faire fonctionner le chauffage.
L'eau potable vient à manquer. Les employés en sont réduits à monter, dans des conditions périlleuses, sur le toit des wagons, pour faire fondre un peu de glace. Et, malgré les rationnements, les vivres finissent aussi par s'épuiser.
Quelques villageois, venus voir ce train figé dans la neige, proposent bien quelques victuailles. Mais, connaissant la réputation de ce train de luxe, ils ne les cèdent qu'à des prix astronomiques. On craint même l'attaque des loups !
Si la situation est aussi dramatique, c'est que le train reste bloqué durant cinq jours. Sans aucun moyen de liaison pour savoir ce qui était arrivé au train, la Compagnie finit par envoyer une locomotive chasse-neige à la rencontre du convoi naufragé.
Mais il lui faut près de 24 heures pour ouvrir la voie. Ceci fait, elle remorque l'Orient-Express et ses passagers épuisés vers Istanbul. Mais le trajet sera très long, car la locomotive avance à une allure d'escargot. Cette odyssée fera rapidement le tour du monde.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 11 Dec 2023 - 1min - 1396 - Quelles ont été les différentes peines de mort dans l'Histoire ?
L'existence de la peine de mort, comme sanction d'un fait délictueux, est attestée depuis la plus haute Antiquité. Le code babylonien d'Hammurabi, dont la rédaction remonte à environ 1.750 avant J.-C., en fait déjà mention.
Quand il s'agit d'infliger des châtiments à leurs semblables, l'imagination des hommes ne semble pas connaître de limites. Aussi les modes d'exécution ont-ils été fort divers.
Sous l'Ancien Régime, en France, les roturiers reconnus coupables d'un crime étaient le plus souvent pendus et les nobles décapités, à l'épée ou à la hache. Mais certains châtiments étaient encore plus terribles.
Ainsi, certains meurtriers étaient condamnés au supplice de la roue, au cours duquel leurs membres étaient brisés. Quant aux régicides et parricides, ils étaient écartelés par des chevaux attachés aux bras et aux jambes.
On sait qu'au cours de l'Histoire, d'autres supplices horribles, comme le bûcher, pour les hérétiques et les sorcières, la crucifixion, l'emmurement ou l'empalement ont été pratiqués.
Si, en 2022, 142 pays avaient aboli la peine de mort, 53 l'appliquaient encore. Ce qui était aussi le cas de nombreux États américains.
Les méthodes d'exécution mises en œuvre dans ces pays sont aujourd'hui plus limitées. L'une d'entre d'elles s'efforce de réduire la souffrance ressentie par le condamné. Il s'agit de l'injection de substances létales, méthode utilisée aux États-Unis, mais aussi en Chine et au Vietnam.
On sait que le recours à la chaise électrique, mode d'exécution emblématique aux États-Unis, pouvait se traduire, malgré les dires de certains, par d'intenses souffrances, surtout si la décharge électrique était mal réglée.
D'autres modes d'exécution sont conformes aux "traditions", si l'on peut dire. C'est le cas de la pendaison, pratiquée par de nombreux pays, de la décapitation au sabre, qui n'est plus l'apanage que de la seule Arabie Saoudite ou de la fusillade, par un seul exécutant ou un peloton d'exécution.
Mais la lapidation, pratiquée au Soudan et en Iran, témoigne d'un véritable raffinement de cruauté. D'autant que, dans ce dernier pays, les pierres utilisées ne doivent pas être trop grosses, de façon à ne pas infliger la mort trop rapidement.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 10 Dec 2023 - 2min - 1395 - Quel Roi actuel descend de Louis XIV en ligne directe ?
On sait que les Bourbons ont régné sur la France depuis Henri IV. Et ce Roi descendait du dernier fils de saint Louis, et donc d'Hugues Capet.
Or, il existe encore, dans l'Europe actuelle, un représentant des Bourbons. C'est le Roi d'Espagne Felipe VI. En effet, il descend de Louis XIV en ligne directe, donc de son grand-père Henri IV et, à travers lui, du premier Capétien, qui, rappelons-le, monta sur le trône en 987.
Peut-être êtes vous surpris qu'un monarque étranger ait comme ancêtre direct un Roi de France.
Un Roi mort sans héritier
Pour le comprendre, il faut en revenir, justement, à l'époque de Louis XIV. En 1700, le Roi d'Espagne Charles II meurt sans enfants. Dans son testament, il avait désigné comme héritier le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV.
Sa grand-mère était en effet l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, femme de Louis XIV et fille du Roi d'Espagne Philippe IV, père de Charles II.
Le duc d'Anjou, arrière-petit-fils de Philippe IV, monte sur le trône d'Espagne et prend le nom de Philippe V. Son accession déclenche un long conflit, la guerre de Succession d'Espagne.
De 1701 à 1714, elle oppose la France à l'Empereur germanique Léopold Ier, oncle du Roi d'Espagne. Felipe VI (ou Philippe VI en français) est donc le descendant de Philippe V.
Deux prétendants pour un trône
Ce monarque est donc aujourd'hui le chef de la Maison de Bourbon. Mais les deux principaux courants du royalisme français ne le reconnaissent pas comme prétendant au trône de France.
En effet, les orléanistes, partisans du comte de Paris, descendant du frère de Louis XIII et chef de la branche cadette des Bourbons, rappellent que Philippe V avait renoncé, pour lui et ses descendants, au trône de France.
Par ailleurs, ils tiennent pour la loi salique, qui exclut les femmes du trône. Or Felipe VI descend aussi de la Reine Isabelle II. Quant aux légitimistes, qui jugent sans fondement la renonciation de Philippe V, ils reconnaissent comme prétendant un cousin du Roi d'Espagne, le duc d'Anjou.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 07 Dec 2023 - 1min - 1394 - Pourquoi le cardinal Mazarin ne pouvait-il pas célébrer la messe ?
Premier ministre de la Régente Anne d'Autriche et parrain et mentor de Louis XIV, Mazarin est nommé cardinal par le Pape en 1641. On sait que les cardinaux, tout vêtus de rouge, sont les plus hauts dignitaires de l'Église catholique. Ils forment le Sacré Collège, dont la mission est d'élire le Souverain Pontife.
Tout cardinal qu'il fût, Mazarin ne pouvait pas célébrer la messe. Pour la bonne raison qu'il n'était pas prêtre. Il avait pourtant débuté sa carrière dans la diplomatie pontificale, mais n'avait reçu que la tonsure.
Cet usage, qui consistait à raser le haut du crâne de l'impétrant, précédait la collation des quatre ordres mineurs, dont ceux d'exorciste et d'acolyte, et l'ordination elle-même, qui conférait la prêtrise.
Un titre parfois honorifique
Avant d'être élevé au cardinalat, Mazarin était donc un "Monsignore", un prélat distingué par le Pape, sans pour autant être prêtre. Son titre de cardinal devait donc rester purement honorifique.
Il en faisait cependant un prince de l'Église, qui avait la préséance sur les plus grands seigneurs. Pour un homme aux origines sociales modestes, comme Mazarin, ce titre conférait un statut et un prestige indispensables à l'exercice du pouvoir.
De toute façon, il n'était pas rare que des laïcs ou des hommes très jeunes, voire des enfants, appartenant le plus souvent à des familles princières, soient revêtus de la pourpre cardinalice.
Ainsi, le plus jeune fils du Roi d'Espagne Philippe V, Louis Antoine de Bourbon, devient cardinal, et archevêque de Tolède, à l'âge de 8 ans. Quant au célèbre César Borgia, il devient cardinal à 17 ans. Et c'est son père, le Pape Alexandre VI, qui lui remet cette distinction !
Il n'en va plus de même aujourd'hui. Ainsi, certains cardinaux sont les évêques de diocèses près de Rome, d'autres, les cardinaux-prêtres, sont titulaires d'une paroisse romaine. Enfin, les cardinaux-diacres ont la charge d'une chapelle, ou diaconie.
Aussi les cardinaux actuels ne pourraient pas se retrouver dans la situation de Mazarin qui, malgré son titre de cardinal, avait moins de pouvoirs, en matière religieuse, que le plus modeste prêtre de province.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 06 Dec 2023 - 2min - 1393 - Quelle est la face cachée de Simone de Beauvoir ?
Auteur du "Deuxième sexe" et militante engagée auprès du "Mouvement de libération des femmes" (MLF) dans les années 1970, Simone de Beauvoir est considérée par les féministes comme une figure tutélaire.
Par ailleurs, son long compagnonnage avec Jean-Paul Sartre, dont elle a partagé certains combats, comme celui pour la décolonisation, lui ont ajouté une aura intellectuelle que rien ne semblait pouvoir ternir.
Et pourtant, des témoignages et des livres récents tendent à déboulonner la statue que ses thuriféraires ont érigée à Simone de Beauvoir.
Amour de midinette et passivité politique
Des militantes féministes ont exprimé leur déception face à une femme qui fut l'une des premières à incarner leur combat. Elles lui reprochent ainsi d'avoir connu plusieurs relations lesbiennes sans jamais reconnaître sa bisexualité ni prendre ouvertement la défense de l'homosexualité.
Par ailleurs, la relation que noua Simone de Beauvoir avec le romancier américain Nelson Algren ne laisse pas non plus de les décevoir. D'aucuns, en effet, comparent cet amour exclusif et sensuel à une passion de midinette.
D'autant que la philosophe s'y comporte comme la femme soumise qu'elle dénonçait dans ses écrits, prête à se contenter des tâches ménagères.
Quant à l'engagement politique de l'écrivain, il sème aussi le doute parmi ses partisans. À vrai dire, la politique ne passionnait guère Simone de Beauvoir. Elle ne s'y intéressera quelque peu qu'après la guerre, sous l'influence de Sartre.
Durant l'Occupation, elle semble surtout se consacrer à son œuvre. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir travaillé à "Radio Vichy" et d'être restée passive tout au long de la guerre.
Ses partisans rappellent que Simone de Beauvoir aurait fondé, avec Sartre, un mouvement de résistance, "Socialisme et liberté". Cependant, l'existence de cet organisme paraît très douteuse à certains historiens.
D'autres aspects de sa personnalité, comme son goût pour les très jeunes femmes, dont plusieurs de ses élèves, ou son addiction à l'alcool, peuvent encore lézarder l'image de la militante engagée. On peut aussi penser que, pour une femme qui avait très tôt dénoncé le corset des conventions bourgeoises, c'était une manière d'assumer sa liberté.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 04 Dec 2023 - 2min - 1392 - Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été retiré de la Bible ?
On se doute que le contenu de la Bible a fait l'objet d'un soin particulier. Les livres qui ont été retenus font partie de ce que l'on appelle le "canon" de la Bible. Ils sont donc seuls considérés comme authentiques.
Ce n'est pas le cas du livre d'Enoch, ou Hénoch. Il avait déjà été retiré de la Bible hébraïque et ne faisait pas partie de la Septante, la première traduction en grec, au IIIe siècle avant notre ère, de cette Bible hébraïque. Ce livre a tout de même été intégré au canon de l'Église chrétienne d'Éthiopie.
Enoch était présenté comme le grand-père de Mathusalem et l'arrière-grand-père de Noé. Comme ces derniers, c'est l'un des grands patriarches de la Bible. Selon les spécialistes, le livre qui porte son nom aurait été rédigé entre le IVe et le Ier siècle avant J.-C.
Des doutes sur l'auteur et le contenu
Mais comment expliquer cette méfiance de l'Église à l'égard du livre d'Enoch ? Une première raison peut être trouvée dans l'identité de l'auteur du texte. En effet, le livre d'Enoch est considéré comme un texte pseudépigraphique.
Autrement dit, un texte qui n'a pas été écrit par son auteur déclaré. En effet, Enoch aurait vécu bien avant le Déluge, à une époque très antérieure à la rédaction du texte qui devait porter son nom.
Cette exclusion s'explique aussi par le contenu du livre. De nature essentiellement apocalyptique, il met en scène des anges déchus. De leur commerce avec des femmes, seraient nés des géants qui auraient dévoré les hommes.
Le livre d'Enoch contient aussi des visions et des paraboles, mêlées à des considérations sur l'astronomie. Les passages sur les anges ont sans doute paru trop fantaisistes aux pères de l'Église, qui ne les ont pas retenus. Aucun de leurs noms n'est d'ailleurs repris dans la Bible.
Même s'il a été exclu de la Bible, le livre d'Enoch a sans doute influencé tous ses passages apocalyptiques, qui annoncent la fin des temps et le Jugement dernier. Enoch lui-même est cité plusieurs fois dans la Bible.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 03 Dec 2023 - 1min - 1391 - Quel pays a perdu la moitié de sa population à cause d'une famine ?
La famine qui touche l'Irlande, entre 1845 et 1852, ne fait pas autant de victimes que l'Holodomor, cette terrible famine qui, entre 1932 et 1933, tue entre 2,5 et 5 millions d'Ukrainiens.
Mais cette "famine de la pomme de terre", comme on l'a appelée, est tout de même une effroyable catastrophe. Elle fit environ un million de morts, auxquels il faut ajouter environ 1,5 million de personnes décidant de quitter le pays.
L'Irlande, peuplée alors d'environ 8,5 millions d'habitants, perdit donc plus du quart de sa population, plus encore pour certains historiens. Et cette ponction fut si importante qu'il fallut attendre jusqu'au début de l'année 2021 pour que le pays retrouve à peu près son niveau de population du milieu du XIXe siècle.
Les chiffres ne sont cependant pas tout à fait comparables, dans la mesure où, en 1850, l'Irlande se composait de toute l'île, alors que, depuis 1921, le pays est divisé en deux entités.
Ce qui a provoqué la grande famine irlandaise, comme la nomment les historiens, c'est une maladie de la pomme de terre. C'est en effet le mildiou qui a causé cette tragédie. Ce champignon s'attaque à la pomme de terre, mais aussi au raisin ou à la tomate.
Si rien n'est fait pour endiguer le mal, la plante finit par pourrir. Sans doute transporté par des bateaux, depuis l'Amérique du Nord, cette maladie commence à s'attaquer aux cultures au cours de l'été 1845.
L'humidité et la chaleur qui règnent alors sont des conditions idéales pour la propagation du mildiou. Dès l'automne, un tiers de la récolte est perdu.
Ce n'est pas la première fois que l'Irlande est confrontée à la famine, mais elle n'avait jamais duré aussi longtemps que celle qui commence en 1845. Et la situation est d'autant plus grave que la base du régime alimentaire du peuple irlandais est la pomme de terre.
Le gouvernement reste impuissant devant la catastrophe, car sa cause n'est pas identifiée. En tous cas, cette terrible épreuve marquera durablement la mémoire collective des Irlandais.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 30 Nov 2023 - 2min - 1390 - Qu'est-ce qu'un « chien sanitaire » ?
L'augmentation du nombre de soldats engagés dans les conflits, à partir du XIXe siècle, et l'utilisation d'armes toujours plus meurtrières, accroissent le nombre de victimes. Dès lors, il n'est pas toujours aisé de retrouver les blessés, dispersés sur de vastes champs de bataille.
Les repérer est d'autant plus difficile qu'il faut souvent les chercher la nuit et qu'ils n'ont pas toujours la force de signaler leur présence.
Aussi pense-t-on, dans certains pays, à confier cette tâche à des chiens, spécialement dressés pour chercher les blessés. Les Allemands sont les premiers à faire appel à ces "chiens sanitaires".
Ils commencent à les élever à cette fin dès la fin du XIXe siècle. Juste avant le début de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande dispose déjà de 2.000 chiens, prêts à parcourir les champs de bataille, à la recherche des blessés.
En France, l'intérêt pour les chiens sanitaires est plus tardif. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'est fondée la Société d'étude pour le dressage des chiens sanitaires. En 1908, elle devient la Société nationale du chien sanitaire.
Ses créateurs ne ménagent pas leurs efforts pour persuader l'opinion publique, et surtout l'armée, de l'intérêt de ces animaux, dont le puissant odorat permettra de retrouver plus rapidement les blessés, abrégeant ainsi leurs souffrances.
Les militaires finissent par se laisser convaincre. Ainsi, à la veille de la guerre, en 1911, un premier chenil militaire est ouvert. Deux ans plus tard, les chiens sanitaires, tenus en laisse par leurs maîtres, défilent avec l'armée à l'occasion du 14 Juillet.
Pour être efficaces, ces chiens doivent être choisis avec soin. Couchant dehors par tous les temps, ils doivent résister au froid et à la pluie. Leurs maîtres n'ayant guère le temps de les bichonner, ils doivent être d'un entretien facile.
Enfin, ils doivent être robustes et posséder un flair infaillible. Les bergers allemands semblaient tout indiqués pour remplir cette mission, mais le patriotisme se glissant, surtout en ces temps de guerre, dans les plus menus détails, les militaires préfèrent dresser des chiens "français".
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 29 Nov 2023 - 1min - 1389 - Depuis quand buvons-nous de l'alcool ?
Le nouveau podcast Le coin philo est disponible sur:
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-coin-philo/id1713311087
Spotify:
https://open.spotify.com/show/09CceBeXcjCF1I3DlxT0ZE
Deezer:
https://deezer.com/show/1000376661
--------------------------------------
L'alcool est obtenu par la fermentation de végétaux, pas seulement des fruits d'ailleurs, comme le raisin ou la pomme, mais aussi des céréales, comme l'orge ou le maïs, ou encore la canne à sucre ou la betterave.
Les scientifiques ont conclu de l'examen de certains fragments de poterie que, dès le Néolithique, soit vers 8.000 ans avant J.-C., les hommes maîtrisaient les techniques de fermentation nécessaires à la fabrication de l'alcool.
Des tessons de poterie datant d'environ 9.000 ans, et trouvés en Chine, ont ainsi révélé la présence d'un alcool fabriqué avec du riz et du miel. Dès cette époque, qui vit aussi la mise en place de l'agriculture et de l'élevage, les hommes savaient donc produire du vin, dont les usages étaient divers.
Certains scientifiques prétendent même que la culture du blé, qui marque les débuts de l'agriculture, et la sédentarisation qui en est le résultat, n'aurait pas été entreprise pour fabriquer du pain, mais de la bière !
Ces premiers agriculteurs auraient d'abord obtenu une sorte de bouillie qui, en fermentant, aurait donné de la bière. Ce n'est que dans un second temps qu'ils auraient songé à faire du pain.
Ceci étant, il est possible que les hommes préhistoriques aient pu goûter de l'alcool avant cette date. Cette dégustation a pu se faire à partir de fruits pourris, qui fermentaient naturellement à l'air libre.
Une pratique qui a d'ailleurs été remarquée chez certains animaux, comme les grands singes. Mais il est évidemment impossible, en l'absence de toute trace archéologique de cette consommation d'alcool, de donner une date précise à une telle découverte.
Mais, une fois maîtrisée la fabrication de l'alcool, les hommes n'ont pas tardé à la codifier. Ainsi, les anciens Égyptiens ont consigné avec soin les étapes de la fabrication et les diverses méthodes de production du vin, mais aussi de la bière.
Quant à l'eau-de vie, on ne saura la fabriquer, par distillation, que bien plus tard. En effet, le premier alambic ne voit le jour qu'au VIIIe siècle, dans l'Irak actuel.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 27 Nov 2023 - 2min - 1388 - Pourquoi la communauté Osage a-t-elle été massacrée ?
Le dernier film de Martin Scorcese, "Killers of the flower moon", met en scène des personnages et des péripéties qui semblent tirés du cerveau fertile de ses scénaristes.
Or, ils correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Les malheureux héros de cette histoire sont les indiens Osages. Installés, à l'origine, dans le Mississipi et la vallée de l'Ohio, ils ont été déplacés, à la fin du XIXe siècle, vers une réserve de l'Oklahoma, au centre du pays.
Les terres y étaient inhospitalières, du moins à première vue. Aussi, en 1906, le gouvernement fédéral pense-t-il se montrer généreux à peu de frais en accordant à la communauté Osage la propriété des ressources minérales présentes dans le sol.
Une série de meurtres
Or on s'aperçoit, dans les années 1920, que cette réserve recèle des richesses inattendues. En effet, le sous-sol regorge de pétrole. En principe, les Osages en sont les seuls propriétaires. Et l'accord de 1906 leur interdit même de céder leurs terrains.
Mais les pionniers blancs n'entendent pas laisser passer cette occasion de faire fortune. Nombre d'entre eux épousent alors des indiennes et entrent ainsi dans des familles enrichies.
Et ils gèrent même leur fortune, profitant d'une décision des autorités fédérales, qui juge les Osages "incompétents", donc incapables de s'occuper de leurs affaires.
Mais il y a pire. Pour s'emparer de leur fortune, des colons blancs décident de supprimer des membres de la communauté osage. Durant le "règne de la terreur", entre 1921 et 1925, on estime ainsi que 60 Indiens ont été assassinés, le nombre de victimes étant peut-être encore plus élevé.
Le FBI, auquel l'enquête a été confiée, met notamment au jour la machination ourdie par un éleveur blanc, William Hale, qui, avec l'aide de son neveu, planifie les meurtres de toute une famille. Seule une des sœurs échappe de peu à une tentative d'empoisonnement.
Les deux assassins sont condamnés à la détention à perpétuité. Mais les autres meurtres demeurent impunis. Aujourd'hui encore, les Osages essaient de récupérer des concessions pétrolières acquises, selon eux, par des moyens frauduleux.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 26 Nov 2023 - 2min - 1387 - Quel était le code de conduite des pirates ?
La vue du drapeau des pirates faisait frémir les équipages des navires qui l'apercevaient, car la réputation de férocité de ces écumeurs des mers n'était pas toujours usurpée.
Et pourtant ces hommes en rupture de ban devaient se soumettre à certaines règles. En effet, certains chefs de bandes ont élaboré des sortes de codes, souvent connues sous le nom de "chasses-parties".
Ces conventions sont d'abord le fait des corsaires, avant d'être adoptées par les pirates. L'un des codes les plus connus est celui mis au point, en 1720, par le célèbre pirate anglais Bartholomew Roberts, dit "Black Bart".
Démocratie et discipline
La lecture de ces codes, et notamment de celui de Bartholomew Roberts, ne laisse pas d'être surprenante. En effet, ils comprennent des usages démocratiques inconnus des sociétés de l'époque.
De fait, les membres de l'équipage peuvent se prononcer, par vote, sur les affaires importantes. On discerne également, dans ces textes, une certaine forme de solidarité entre les pirates.
En effet, il existe une caisse commune, dans laquelle on puisera pour compléter la part d'un pirate que ses blessures laissent handicapé.
Plusieurs clauses ont pour but de faire régner une stricte discipline à bord. Ainsi, le vol est sévèrement puni. Un pirate qui prend plus que sa part de butin est abandonné sur une île déserte. S'il vole l'un de ses compagnons d'armes, il est condamné à avoir le nez et les oreilles coupés.
Pour éviter tout débordement, les rixes sont interdites sur le bateau. Mais les querelles entre deux matelots peuvent se régler au pistolet ou au sabre.
Dans la même logique, tout ce qui peut dégénérer en bagarre est proscrit. C'est le cas des jeux d'argent, mais aussi de la présence des femmes à bord des navires. Celle-ci pourrait d'ailleurs distraire les hommes d'équipage, qui doivent, à tout moment, de tenir prêts au combat.
Enfin, aucun pirate ne peut "démissionner" avant d'avoir amassé un certain butin. Sans doute craignait-on que les éventuelles révélations de ces pirates repentis ne puissent compromettre la sécurité de leurs camarades.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 23 Nov 2023 - 1min - 1386 - Pourquoi le mystérieux État libre du Goulot est-il né d'une erreur ?
À la suite de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, adopté en 1919, impose la démilitarisation de la Rhénanie. Pour vérifier l'effectivité de cette mesure, la région est découpée en trois secteurs, occupées par les armées alliées pour une durée allant de 5 à 15 ans.
Les zones concernées se trouvent à l'ouest du Rhin, mais comprennent aussi des têtes de pont sur la rive droite du fleuve. Elles sont centrées sur Cologne, Mayence et Coblence. Mais les militaires chargés de délimiter ces secteurs circulaires, sur la carte, commettent une erreur.
En effet, les zones française et américaine auraient dû se toucher, de sorte qu'aucun secteur ne soit laissé en dehors de l'administration militaire alliée.
Toutes les apparences d'un État souverain
Or, ce n'est pas ce qui se passe. Un étroit couloir, mesurant moins de 800 mètres de large en son point le plus étroit, se trouve libre de toute occupation. Cet étroit corridor, coincé entre les zones française et américaine, va devenir l'État libre du Goulot.
On lui donne ce nom en raison de sa forme qui, en effet, rappelle celle du goulot d'une bouteille. C'est le maire de Lorch, la ville la plus importante du territoire, et qui en devient la capitale, qui annonce, par un télégramme aux Alliés, la formation de ce micro État.
Il comporte environ 17.000 habitants, qui vivent dans les villes de Lorch et de Caub, et dans plusieurs villages. Le nouveau pays se dote de certains des symboles de la souveraineté. Une nouvelle monnaie est en effet créée, le thaler de l'État libre, qui n'a cours que dans ce petit pays, qui émet aussi des passeports.
Mais les Français ne l'entendent pas de cette oreille. Décidés à faire rentrer ces récalcitrants dans le rang, ils isolent le minuscule État. Aussi les vivres entrent-ils par contrebande dans le territoire.
L'expérience prend fin en février 1923, à la suite de l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises, qui devait contraindrez l'Allemagne à payer les réparations prévues par le traité de Versailles.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 22 Nov 2023 - 1min - 1385 - Pourquoi l'histoire de Radio Caroline est-elle incroyable ?
Au début des années 1960, les jeunes Anglais découvrent, dans le sillage des Beatles et d'autres groupes à la mode, les rythmes saccadés de la musique pop. Les médias, et notamment la BBC, tentent de se mettre au diapason.
Mais la radio d'État, qui a alors le monopole de la diffusion, ne consacre que quelques heures à cette nouvelle musique. Frustrée, la jeunesse britannique se tourne alors vers une nouvelle station, Radio Caroline, créée en 1964.
Installée sur un bateau, elle émet de la musique pop toute la journée. Elle ne se contente d'ailleurs pas, comme la BBC, des grands succès du moment. Elle fait aussi découvrir de nouveaux titres, dont certains deviennent vite très populaires.
Une histoire chaotique
Radio Caroline vient donc compléter la programmation de la BBC, dont la jeunesse ne représente pas le principal public. Mais les choses ne sont pas si simples. La BBC ayant le monopole de la diffusion, cette nouvelle station est donc une radio pirate.
Jusqu'en 1967, le gouvernement britannique tolère cette radio, dans la mesure où le bateau qui l'abrite croise dans des eaux internationales. Mais d'autres stations, comme Radio Atlanta, qui fusionnera avec Radio Caroline, se mettent à diffuser de la musique.
Les radios pirates se multipliant, les autorités finissent par les interdire. De toute façon, Radio Caroline a des difficultés financières, et ses créanciers finissent par mettre la main sur le bateau qui l'héberge !
En 1972, le navire arrive tout de même au large des Pays-Bas, qui ne lui réserve pas un meilleur accueil et interdit à son tour les radios libres. Et il finit même par sombrer quelques années plus tard, en 1980.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre bateau accueille Radio Caroline en 1983. Mais, une fois encore, l'argent vient à manquer et l'expérience tourne court en 1990.
Hébergée aujourd'hui par un studio londonien, la station, qui a d'ailleurs perdu son identité, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il est vrai qu'elle doit faire face à une rude concurrence. Quelques milliers d'auditeurs lui sont encore fidèles, mais on est loin du succès d'antan.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 20 Nov 2023 - 1min - 1384 - Qu'est-ce qu'une « catapulte à bombardiers » ?
Des archéologues britanniques ont mis au jour un ingénieux dispositif de lacement des avions, datant de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une grande catapulte, qui devait propulser dans les airs des bombardiers prenant leur élan sur des pistes très courtes.
Ce système de lancement a été élaboré entre 1938 et 1940. Il se présente sous la forme d'une vaste fosse circulaire, sur laquelle une plaque tournante a été construite. elle oriente ensuite l'avion sur l'une des pistes d'envol. Celui-ci est relié à un vérin pneumatique souterrain, par lequel il reçoit de l'air à haute pression.
La force emmagasinée par cet air était telle que l'avion pouvait décoller après avoir parcouru la courte distance de 82 mètres, la longueur des deux pistes construites. Grâce à cette catapulte, les avions, qui prenaient leur envol sur des pistes plus courtes, dépensaient moins de carburant.
Une catapulte à l'origine d'un autre système
En fait, cet ambitieux système de lancement n'a jamais fonctionné. Durant les phases d'essai, en effet, les moteurs chargés de comprimer l'air ont montré leurs limites, et le dispositif s'est révélé peu adapté à la propulsion des bombardiers.
Mais cette technologie n'a pas été perdue. Elle a inspiré la mise au point, en 1941, d'un autre système de propulsion des avions : le dispositif de catapulte de navires marchands d'avions (CAM).
Grâce à ce système, des chasseurs britanniques pouvaient s'envoler du pont de cargos pourtant peu adaptés au décollage d'avions. En fait, ils étaient montés sur une sorte de chariot, propulsé par une fusée.
C'est pour compenser le manque relatif de porte-avions que plus de 30 navires marchands ont été convertis de la sorte. Les chasseurs ainsi catapultés ont largement contribué à la protection des convois de navires alliés.
Par contre, aucune piste d'atterrissage n'était prévu pour les accueillir au retour de leur mission. Le pilote devait donc s'éjecter en vol et attendre d'être récupéré. Les avions étaient donc perdus.
Après la guerre, la fosse creusée pour recevoir la catapulte a abrité, durant un certain temps, des déchets radioactifs.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 19 Nov 2023 - 2min - 1383 - Quel champion cycliste sauva des juifs ?
Pour écouter l'épisode "Pourquoi l'inceste n'est pas un crime ?":
Apple Podcasts:
https://itunes.apple.com/fr/podcast/choses-%C3%A0-savoir/id1048372492
Spotify:
https://open.spotify.com/show/3AL8eKPHOUINc6usVSbRo3
Deezer:
https://www.deezer.com/fr/show/51298
-----------------------------
Le cycliste italien Gino Bartali, né en 1914, près de Florence, s'est fait une place de choix dans les annales du tour de France, qu'il remporte à deux reprises, en 1938 et 1948. Il inscrit aussi trois tours d'Italie et quatre victoire dans la course Milan-San Remo à son palmarès. Mais il n'est pas seulement connu pour ses performances sportives.
Durant la Seconde Guerre mondiale, sa foi très vive le conduit à s'intéresser au sort des opprimés. Alerté, par certains ecclésiastiques, sur la situation des juifs, il décide de leur venir en aide.
Il se met donc à transporter de faux papiers, destinés aux nombreux juifs recueillis par les couvents de la péninsule. De précieux documents, qui pouvaient leur sauver la vie. Il fait alors des centaines de kilomètres à vélo, passant par Assise, en Ombrie, et allant jusqu'à Gênes ou dans les Abruzzes.
Gino Bartali invoque la nécessité de s'entraîner régulièrement pour justifier ces déplacements quotidiens.
Juste parmi les nations
Ses convictions religieuses poussent donc le cycliste à rejeter les avances du régime fasciste, qui aurait bien voulu en faire un objet de propagande, et à s'engager dans la résistance.
Et c'est sa notoriété qui va le protéger dans ses activités clandestines. S'il n'avait pas été un célèbre champion cycliste, connu de tous les Italiens, il n'aurait pas pu cacher longtemps les documents dissimulés dans le cadre ou la selle de son vélo.
Mais quel policier penserait à fouiller le grand Gino Bartali, gloire de l'Italie ? Aussi passait-il sans encombres tous les barrages mis en place par la police. Il profitait aussi de ses voyages pour repérer les mouvements des armées allemandes, collectant ainsi de précieux renseignements pour la résistance italienne.
On finit tout de même par soupçonner Gino Bartali, qui fut même arrêté. Mais, là encore, sa célébrité le tira d'affaire.
Le champion cycliste ne se vanta jamais de son action durant la guerre. Elle ne fut réellement découverte qu'après sa mort. C'est donc à titre posthume qu'il fut élevé au titre de Juste parmi les nations.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 16 Nov 2023 - 2min - 1382 - Pourquoi personne ne veut ouvrir le tombeau de l'Empereur Qin Shi Huang ?
Unifiant les principaux Royaumes Combattants, qui composaient alors la Chine, Qin Shi Huang en est considéré comme le premier Empereur. En tant que tel, il régna sur le pays de 221 à 210 avant notre ère. On lui doit notamment la mise en place d'une langue et d'une monnaie communes.
C'est également lui qui aurait ordonné la construction de la Grande Muraille de Chine. L'ouverture du tombeau de ce premier Empereur de Chine apporterait sans doute aux archéologues de précieuses indications sur la civilisation de cette époque.
On en a d'ailleurs découvert certains éléments, comme cette extraordinaire armée inanimée, composée de soldats de terre cuite, gardiens du repos éternel de l'Empereur.
Ce fabuleux ensemble, découvert en 1974 et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, se trouve à environ 1,5 km du mausolée lui-même. Certaines parties en sont déjà ouvertes au public.
Une tombe piégée ?
Mais la tombe elle-même n'a pas encore été ouverte. En effet, les archéologues hésitent à franchir le pas. Non pas qu'ils craignent une malédiction, comme celle qui, pour certains, est censée s'être abattue sur les découvreurs du tombeau de Toutankhamon.
Ce qui effraie certains d'entre eux, c'est un danger plus matériel. Ils n'excluent pas, en effet, que le souverain ait fait installer, dans la tombe, des pièges qui se déclencheraient dès l'ouverture.
Ainsi, des flèches empoisonnées pourraient, par des mécanismes divers, jaillir de l'obscurité du tombeau pour transpercer les audacieux qui en franchiraient le seuil.
Du mercure nocif pourrait aussi se déverser sur la tête des malheureux. Des taux élevés de mercure ont d'ailleurs été détectés au voisinage du mausolée. Il se pourrait que, d'ores et déjà, des effluves toxiques de ce métal liquide et volatil aient pu s'échapper de la tombe.
C'est d'ailleurs le mercure qui aurait été utilisé pour empoisonner Qin Shi Huang. Ces craintes reposeraient notamment sur les assertions d'un historien chinois du Ier siècle de notre ère, qui affirme que la tombe de l'Empereur était bel et bien piégée. De toute façon, l'ouverture d'un monument aussi ancien risquerait de l'endommager.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 15 Nov 2023 - 2min - 1381 - Comment le Soleil a-t-il participé à la guerre du Vietnam ?
Il se produit, sur notre étoile, à des intervalles réguliers, ce que les spécialistes nomment des éruptions solaires. des jets de particules sont alors propulsées dans l'espace, à des vitesses prodigieuses, de l'ordre de 300 à 1.000 kilomètres par seconde.
Par ailleurs, l'énergie libérée à la surface du Soleil, notamment sous forme de nuages de plasma, donne lieu à des phénomènes spectaculaires, comme les aurores boréales.
Certaines tempêtes solaires sont plus puissantes que d'autres. C'est le cas de celle qui se produit entre le 2 et le 4 août 1972. Ce jour-là, en particulier, une violente éruption solaire projette des particules vers la Terre à la vitesse de 10 millions de km/h.
Ce phénomène fait naître d'impressionnantes aurores boréales en Amérique du Nord. Mais il perturbe aussi les réseaux électriques et de communications.
Actuellement, le Soleil est peu actif et, jusqu'à la fin de cette décennie, aucune tempête solaire ne devrait en principe se produire.
Des explosions de mines
Mais, selon toute probabilité, la tempête solaire de 1972 a eu une autre conséquence, celle-ci plus inattendue. En effet, elle aurait fait exploser des mines magnétiques que, dans le cadre de la guerre du Vietnam, l'aviation américaine avait larguées au large des ports du Nord Vietnam.
Dans un premier temps, plus d'une vingtaine d'explosions sont détectées. En fait, des investigations ultérieures font état de détonations beaucoup plus nombreuses. Les militaires en auraient en effet enregistré plus de 4.000 dans cette région.
Ce qui représenterait plus du tiers des quelque 11.000 mines larguées par l'aviation dans cette zone entre mai 1972 et janvier 1973.
Elles sont censées exploser quand le champ magnétique se modifie. Ce qui devait normalement se produire au passage d'un bateau. Privés, par l'action du Soleil, d'une partie de leur arsenal militaire, les Américains se voyaient donc affaiblis face à leurs ennemis.
L'armée américaine avait réfléchi à l'impact de l'activité solaire sur certains de ses équipements. Mais, à l'évidence, ses experts avaient mal évalué les conséquences des tempêtes solaires les plus violentes. C'est pour en tenir mieux compte que l'armée a modifié le fonctionnement de ses mines magnétiques.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Mon, 13 Nov 2023 - 1min - 1380 - Le « vrai » Dracula pleurait-il des larmes de sang ?
Vlad III l'Empaleur règne sur la principauté de Valachie, à l'origine de la Roumanie, au milieu du XVe siècle. L'un de ces surnoms, "Draculea", qui signifie "fils du dragon", fut repris, au XIXe siècle, par Bram Stoker, qui en fit le fameux vampire Dracula. Il était d'ailleurs déjà porté par son père.
Si ce prince servit de modèle au romancier, c'est qu'il traînait derrière lui une réputation sanguinaire, comme en atteste son surnom. En effet, il aurait fait subir à ses opposants les plus horribles supplices, dont l'empalement.
En fait, il semble que ces méfaits relèvent plus, dans leur ensemble, de la légende que de la réalité. Ce qui ne veut pas dire que ce prince valache n'ait montré aucune violence dans la répression de ses opposants.
Des larmes de sang
Il est bien malaisé, aujourd'hui, de s'inscrire en faux contre la légende démoniaque de Vlad l'Empaleur. D'autant qu'un fait nouveau pourrait encore l'accréditer.
En effet, des chercheurs ont fait une curieuse découverte en examinant trois lettres laissées par le seigneur valache. Ils ont retrouvé, sur le papier, des peptides, qui sont de courtes séquences d'acides aminés.
Elles provenaient du liquide lacrymal et de la rétine. Et leur analyse aurait montré que les larmes de Vlad III auraient été sanguinolentes. Autrement dit, ce prince aurait pleuré du sang ! Si, du moins, c'est bien lui qui a versé les larmes dont on a retrouvé la trace sur le papier.
Si cela est avéré, Vlad III aurait souffert d'hémolacrie. Une maladie rarissime, qui ne toucherait que quelques personnes dans le monde. En fait, ce n'est pas du sang qui coule des yeux des malades, mais plutôt des larmes teintées de sang. La maladie peut aussi s'accompagner de maux de tête et de saignement du nez.
Analysées avec des méthodes très modernes, ces lettres ont apporté d'autres renseignements aux scientifiques. Outre des empreintes, ils y ont en effet repéré un peu de sueur et de salive. Ces éléments, et quelques autres, donnent des indications sur l'état de santé et les habitudes alimentaires de Vlad l'Empaleur.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Sun, 12 Nov 2023 - 1min - 1379 - Pourquoi les Apaches ont terrorisé Paris ?
Le phénomène de bandes de jeunes tombant parfois dans la délinquance n'est pas propre à notre époque. On le rencontre déjà dans le Paris de la Belle Époque, au début du XXe siècle.
Coiffés de larges casquettes, un foulard aux couleurs vives noué autour du cou, ces "voyous" sont souvent très jeunes, certains étant même à peine entrés dans l'adolescence.
On les appelle des "apaches". Ces Indiens d'Amérique, les Parisiens ne les avaient pas vus au cinéma, encore balbutiant, mais dans le spectacle du célèbre Buffalo Bill qui, en 1889 et 1905, est présenté dans la capitale.
Ce "wild west show" obtient un triomphe et familiarise les spectateurs avec ces "Apaches" sanguinaires qui scalpent leurs ennemis. Le nom de ces nouveaux "sauvages" parisiens, qui terrorisaient les honnêtes gens, était tout trouvé.
Des codes bien particuliers
Les apaches parisiens viennent souvent de l'Est de la capitale. Ils fréquentent aussi les "fortifs". Bordant la ville, à proximité de l'enceinte élevée sous la Monarchie de Juillet, le secteur, réputé mal famé, abrite une population interlope.
Ces bandes, qui se donnent des noms pittoresques, comme "les loups de la butte" ou "les chevaliers du sac", défendent bec et ongles un territoire qu'ils considèrent comme leur propriété.
C'est dire que les bagarres entre bandes rivales sont fréquentes. Souvent sans domicile fixe, ces jeunes en rupture de ban ne fréquentent aucune école. Volontiers anarchistes, ils professent une haine jamais assouvie pour les bourgeois et les autorités, au premier rang desquelles figure la police.
Les rapines diverses et les démêlés avec les agents conduisent souvent les apaches en prison. C'est pour eux un titre de gloire, dont certains se revendiquent pour prendre de l'ascendant sur leurs camarades et devenir des chefs de bande très respectés.
Souvent tatoués, les apaches remplacent le travail, qu'ils détestent, par la fête et l'alcool. Ils adoptent une allure voyante, faite pour attirer l'attention sur eux.
Les femmes intègrent souvent leurs bandes. Elles y jouissent d'une liberté de mouvement et même d'une certaine forme d'égalité, qui tranchent avec le statut des femmes de la bourgeoisie, mises en tutelle par la société.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Thu, 09 Nov 2023 - 2min - 1378 - Pythagore a-t-il vraiment inventé son théorème ?
Qui ne se souvient d'avoir un jour, sur les bancs de l'école, étudié le théorème de Pythagore ? Pour ceux qui l'auraient oublié, il indique que le carré de la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, autrement dit son plus grand côté, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.
Mais ce célèbre théorème est-il bien l'œuvre de Pythagore ? À vrai dire, rien n'est moins sûr. D'abord parce qu'on ne sait pas grand chose de ce philosophe né vers 580 avant notre ère dans l'île de Samos. En effet, il ne nous a laissé aucune œuvre écrite.
Il est possible que ce théorème lui ait été attribué par les disciples de la confrérie mystique qu'il a fondée, où les mathématiques jouent un rôle notable, mais aussi d'autres croyances, comme la réincarnation.
...Mais dont il n'est pas l'auteur
Ni Pythagore, ni les membres de son école d'ailleurs, n'ont formalisé le fameux théorème qui a permis à leur auteur supposé de passer à la postérité.
Les scientifiques pensent qu'il a été découvert beaucoup plus tôt. Un bon millénaire avant l'époque de Pythagore pour être précis. On en a en effet trouvé l'équivalent sur une tablette babylonienne remontant environ à 1.770 ans avant J.-C.
On l'a découverte en Irak, au début des années 1960. C'est là que s'est épanouie, dès 4.500 ans avant notre ère, la civilisation mésopotamienne. Elle a mis au point un système de communication, l'écriture cunéiforme, qu'on retrouve sur la tablette.
Les signes, aussi bien les lettres que les nombres, y sont indiqués par des sortes de clous et de chevrons. Ainsi, dans la tablette en question, les clous figurent les unités et les soixantaines, et les chevrons les dizaines.
Pour les spécialistes, aucun doute : les signes gravés sur cette tablette aboutissent à une démonstration tout à fait comparable à celle qui a donné naissance au théorème que nous attribuons à Pythagore. Ses véritables auteurs, quant à eux, ne lui ont donné aucun nom particulier.
D'autres tablettes, comme celle qui établit le premier plan cadastral connu, confirment la dextérité des Babyloniens à manier les chiffres.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Wed, 08 Nov 2023 - 1min
Podcasts similares a Choses à Savoir HISTOIRE
 Les lectures érotiques de Charlie Charlie F
Les lectures érotiques de Charlie Charlie F Au Cœur de l'Histoire - Des récits pour découvrir et apprendre l'Histoire Europe 1
Au Cœur de l'Histoire - Des récits pour découvrir et apprendre l'Histoire Europe 1 Historiquement vôtre - Stéphane Bern Europe 1
Historiquement vôtre - Stéphane Bern Europe 1 Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1
Hondelatte Raconte - Christophe Hondelatte Europe 1 La libre antenne - Olivier Delacroix Europe 1
La libre antenne - Olivier Delacroix Europe 1 Les Récits extraordinaires de Pierre Bellemare Europe 1 Archives
Les Récits extraordinaires de Pierre Bellemare Europe 1 Archives Les pieds sur terre France Culture
Les pieds sur terre France Culture Affaires sensibles France Inter
Affaires sensibles France Inter C dans l'air France Télévisions
C dans l'air France Télévisions Le Coin Du Crime La Fabrique Du Coin
Le Coin Du Crime La Fabrique Du Coin Manu dans le 6/10 : Le best-of NRJ France
Manu dans le 6/10 : Le best-of NRJ France Franck Ferrand raconte... Radio Classique
Franck Ferrand raconte... Radio Classique L'After Foot RMC
L'After Foot RMC Rothen s'enflamme RMC
Rothen s'enflamme RMC Faites entrer l'accusé RMC Crime
Faites entrer l'accusé RMC Crime Confidentiel RTL
Confidentiel RTL Enquêtes criminelles RTL
Enquêtes criminelles RTL Entrez dans l'Histoire RTL
Entrez dans l'Histoire RTL Laurent Gerra RTL
Laurent Gerra RTL Les Grosses Têtes RTL
Les Grosses Têtes RTL Les histoires incroyables de Pierre Bellemare RTL
Les histoires incroyables de Pierre Bellemare RTL L'Heure Du Crime RTL
L'Heure Du Crime RTL L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel RTL
L’heure du crime : les archives de Jacques Pradel RTL Parlons-Nous RTL
Parlons-Nous RTL